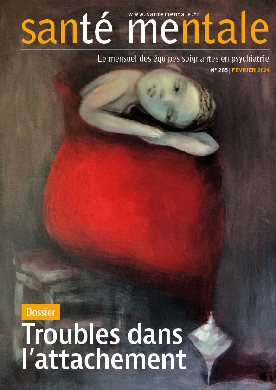L’Alzheimer est une maladie paradoxale. C’est une des pathologies les plus redoutées, mais aussi une des moins graves et des moins douloureuses sur le plan physique, et, dans une certaine mesure, des moins visibles. Si l’étape ultime de la mort peut faire peur, c’est bien ici la dégradation qui effraye, parce qu’on s’y voit disparaître. Quand Épicure affirme que « la mort n’est rien pour nous » (1), puisque soit l’on est présent, et vivant, soit l’on est mort, mais alors on n’est plus là pour le constater, la maladie d’Alzheimer semble le contredire, puisqu’on y est présent physiquement, et mourant personnellement. Il s’agit moins d’un « problème de tuyauterie » comme on entend souvent d’une maladie « classique », que d’un « processus d’anéantissement » (2). Bref, c’est un mal qui affecte nos relations. Relation à nous-même par la conscience de soi et la mémoire, relation aux autres par le dialogue et les liens.
La vie intacte
L’Alzheimer n’est donc pas une pathologie comme les autres. Une maladie affaiblit, fait souffrir, rend la vie moins facile. Ce n’est pas encore la mort qui efface le corps par l’arrêt des fonctions vitales, ce n’est plus la santé qui l’efface dans « le silence des organes » évoqué par Leriche (3), c’est un état intermédiaire où le corps se fait sentir par une douleur, une incommodité, une faiblesse, où ce qui était un instrument est devenu un obstacle.
Dans la maladie d’Alzheimer, au contraire, la vie est intacte : aucune fonction vitale n’est atteinte, aucune souffrance éprouvée, mais c’est la personne qui se perd par anéantissement de la mémoire. L’érosion n’entame plus la valeur de la vie, mais la capacité d’évaluation du malade, et donc son rapport aux autres.
Car même dans la pire maladie, on peut se mettre à la place de l’autre, compatir, soutenir, et espérer, même quand il n’y a plus d’espoir. Ce partage d’esprit est encore une vie qui se déploie et se comprend. Mais quand l’autre devient « autre », autre que lui et que moi, ce partage devient, sinon impossible, du moins altéré, affaibli. Ce n’est plus une souffrance que l’on porte, mais un lien qui s’effiloche. L’ennemi n’est plus en face de nous, dans le parent, l’ami, le patient, dont il faut l’extirper, mais « en nous », comme un patriotisme coupable de ne plus reconnaître son pays.

Déçus et coupables…
Et pourtant, la personne est toujours là. Ce n’est plus exactement celle qu’on a connue, mais elle reste un individu avec sa personnalité, ses souvenirs, ses préférences, sa joie ou sa tristesse, sa peur ou son espoir. Il est là, mais ne répond plus à nos attentes. Nous sommes déçus, et déçus d’être déçus, coupables d’être déçus, presque fautifs d’un changement qu’on pourrait autant imputer à notre attente qu’à la maladie, qui ne consiste en un sens que dans ce décalage. L’habitude des exigences sociales qui valorisent l’individualisme, la performance, l’« entreprise d’être soi » nous rend plus difficile encore le spectacle d’un affaiblissement aussi essentiel. Tout comme l’être bergsonien (4) qui, pour résister au néant, devait disqualifier toute forme d’amoindrissement, et notamment celui du temps et de sa dégradation continuelle, la personnalité d’autrui ne semble pouvoir conserver son statut qu’au prix du rejet de toute faiblesse dans la zone de l’informe.
C’est dire que pour retrouver la personne derrière le rideau de la maladie, il faut déposer les lunettes des préjugés sociaux sédimentés dans notre mémoire, il faut oublier cette mémoire réductrice, pour constater que la mémoire n’est pas tout. Il se peut même qu’on découvre alors une personne plus authentique que celle qu’on croyait connaître. Lors d’une conférence que j’avais faite sur ce sujet, une femme m’a ainsi confié n’avoir jamais eu de meilleure relation avec sa mère que depuis que celle-ci avait développé une maladie d’Alzheimer, qui l’avait débarrassée de ses préventions. Leurs discussions n’étaient plus entravées par tous les calculs et les interdits qui nous promettent d’être quelqu’un, mais finissent par nous couper les uns des autres. La maladie d’Alzheimer jouerait ainsi le rôle révélateur de la mort, décrit par Proust : avant de combattre, le duelliste s’imagine sa vie « remplie des labeurs, des voyages, des courses de montagnes, de toutes les belles choses qu’il se dit que la funeste issue de ce duel pourra rendre impossibles (…). Il revient chez lui sans avoir été même blessé. Mais il retrouve les mêmes obstacles aux plaisirs, aux excursions, aux voyages, à tout ce dont il avait craint un instant d’être à jamais dépouillé par la mort ; il suffit pour cela de la vie » (5).
L’Alzheimer est ainsi une maladie des relations qui peut s’aggraver par une perte de familiarité avec le/la malade, mais aussi s’alléger par une nouvelle manière de le/la regarder. Au-delà des deuils emboîtés et des contraintes écrasantes auxquels elle nous soumet, un regard nettoyé des attentes anciennes peut nous mettre en présence d’une personne nouvelle, sensible, présente à sa façon. Car comme le dit très justement Malherbe (2), la vraie question est moins : « Mon épouse peut-elle encore me reconnaître ? » que : « Moi, puis-je encore la reconnaître ? »
Guillaume Von Der Weid,
Professeur de philosophie
1– Épicure : Lettre à Ménécée, GF, 2009.
2– Malherbe M. Alzheimer, La vie, la mort, la reconnaissance, Vrin, 2015.
3– Leriche, René : “Introduction générale. De la santé à la maladie, la douleur dans les maladies, où va la médecine ?”, Encyclopédie française, t. VI, 1936.
4-–Bergson Henri : L’évolution créatrice, chapitre 4, PUF, Quadrige, 2013.
5– Proust, Marcel, La prisonnière, Pléiade, Gallimard, 1993, p. 591