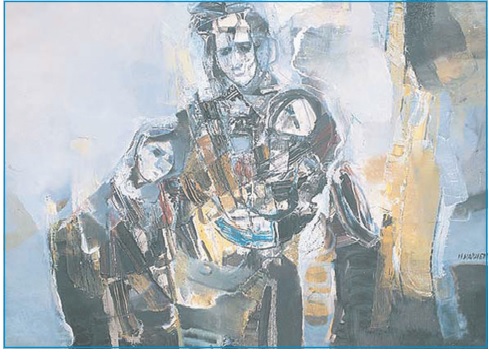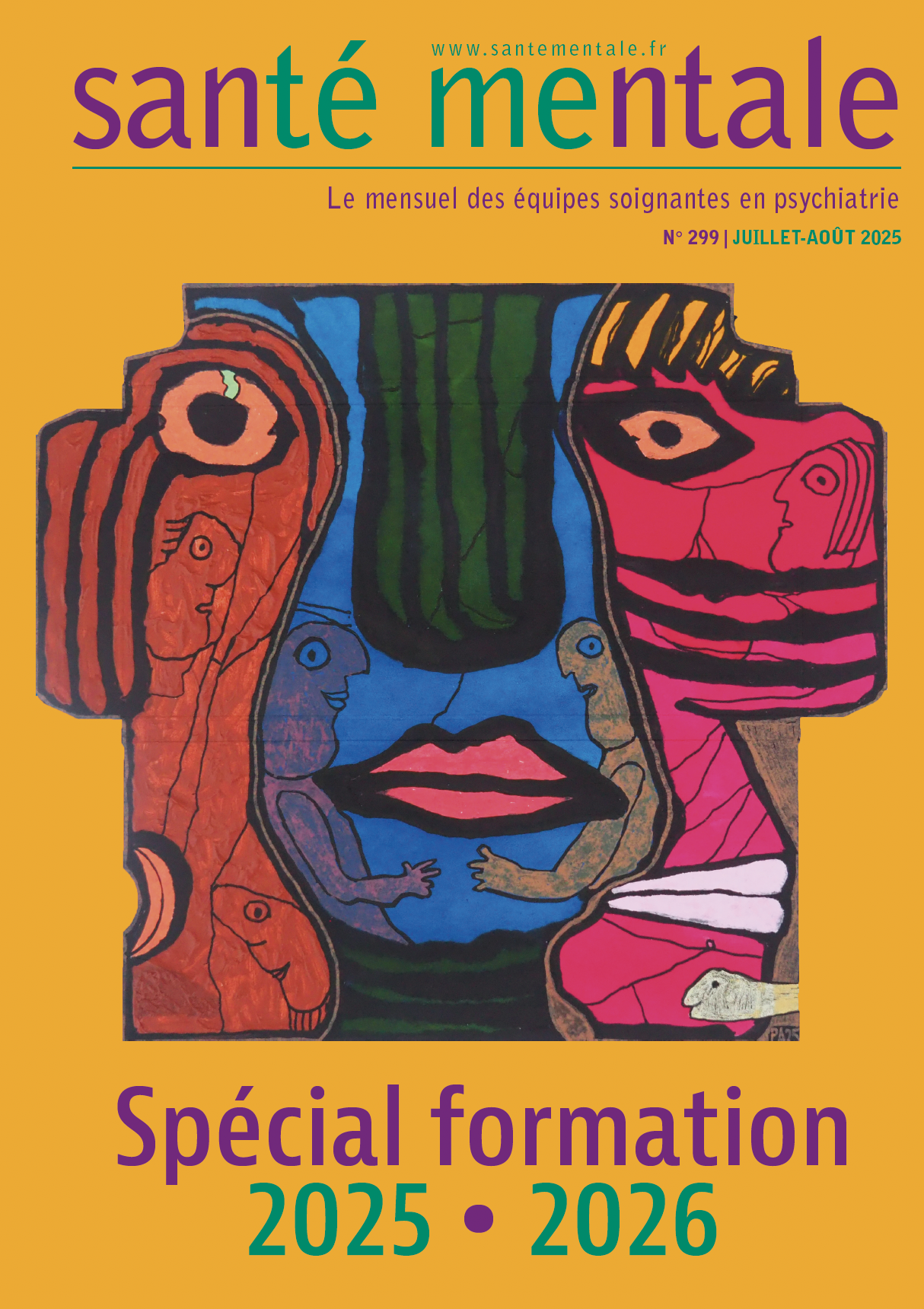Paris
La Société Franco-Algérienne de Psychiatrie organise le 11 octobre 2017 à l’Auditorium de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, un colloque consacré aux aspects mémoriels liés aux traumatismes de la guerre d’Algérie. Notre objectif est de traiter des traumatismes de la mémoire et de la mémoire des traumatismes en croisant divers regards sur la question : ceux d’historiens, d’universitaires, de psychiatres, d’écrivains, de neuropsychologues, …
Ce colloque devrait contribuer à mieux comprendre pourquoi la guerre et les drames vécus il y a près de 60 ans continuent de produire des effets particuliers sur la mémoire. Quels en sont les mécanismes, les processus en cause ? La particularité de la Guerre d’Algérie est qu’elle est l’objet d’une chape de plomb collective et d’un silence général embarrassé et, comme le disait Paul Ricoeur : « je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire – et d’oubli. » Il semble assez clair que la mémoire individuelle entretient des liens étroits avec les représentations collectives et la manière dont sont traités les événements historiques par le corps social dans son entier. Il est probable qu’elle soit soumise à de nombreuses influences, évolutions et changements que lui imprime « la conscience » collective (et/ou l’inconscient). Il y a intrication entre traumatismes,mémoire individuelle, mémoire collective et mémoire historique dans des mouvements multidirectionnels. Ces mêmes phénomènes peuvent être appréhendés en tenant compte des mécanismes biologiques et neuropsychologiques de la mémoire et, à l’inverse, il est difficile de comprendre ces mécanismes sans prendre en compte les influences sociales et collectives.
Il est bien entendu difficile de répondre à de telles questions mais il est essentiel de souligner la nécessité d’une approche multidimensionnelle. Une lecture qui consisterait à réduire les traumatismes de la mémoire à une configuration personnelle singulière ou qui relèverait d’une démarche exclusivement sociale et politique – au risque de dissoudre l’expérience subjective personnelle dans une approche historique globalisante – risque d’être restrictive et réductrice. Au même titre que l’existence d’une problématique individuelle en rapport avec les états post-traumatiques, pourrait on invoquer une forme de traumatisme propre à la société toute entière pour expliquer certaines manifestations de souffrance individuelle ? On voit là toute la complexité de ces questions auxquelles la psychiatrie est soumise.
Pour toutes ces raisons, nous nous inscrivons dans une démarche que l’on pourrait qualifier de « centripète » et à travers les diverses analyses d’historiens, de neuropsychologues, psychiatres, universitaires, écrivains, … sur les liens entre mémoires individuelles, collectives, historiques et mémoires traumatisées, tenter de comprendre un peu mieux les particularités liées à la guerre d’Algérie. Et pour illustrer « l’amnésie collective » qui entoure cette guerre, il est assez significatif de constater la rareté des travaux des psychiatres des deux pays sur cette question essentielle contrairement à d’autres guerres ou conflits qui on donné lieu à une littérature scientifique plutôt abondante.
Programme et renseignements : www.sfapsy.com
Inscriptions en ligne : http://www.katanasante.com/nos-evenements/congres-afmp