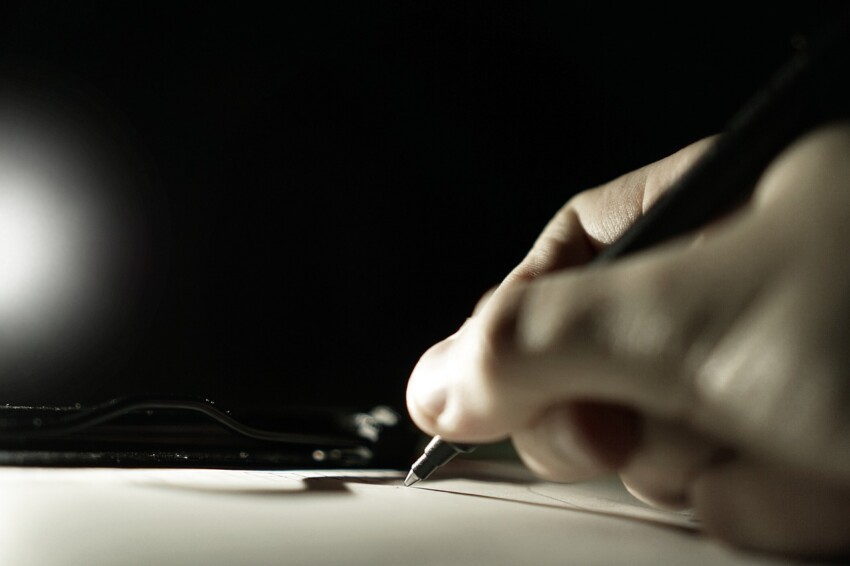Analyser le processus d’écriture, mais aussi le rapport du soignant à l’écriture, un exercice complexe que décrypte pour nous la psychiatre Geneviève Hénault. Ouvrir une page blanche ne lui fait pas peur. Le texte à venir « né d’une urgence à dire« , n’a d’autre finalité que celle de « le jeter dans le monde, le partager« .
Ecrire, ça prend, me prend, comme une urgence. Une urgence éthique à poser un acte de résistance. D’abord, une idée imprécise, parfois seulement embryonnaire, qui pourrait bien se décrocher et aller se balader ailleurs. Mais celle-ci s’accroche et m’entête. Elle récidive et s’affine. S’étoffe, s’épaissit. Elle se trouve des liens à faire dans une conversation, une image. Une première phrase se forme. Parfois je la note, de peur de l’oublier. Souvent, elle ne figurera pas, cette première phrase : elle sera effacée d’un revers de clavier, incipit sacrifié.
Puis, initier le travail : ouvrir une page. Blanche, elle ne me fait pas peur. Le texte est là, il m’est encore inconnu mais les trois coups sont frappés, rideau levé ! Je suis impatiente de le découvrir, ce texte qui travaille en moi. Je le voudrais déjà terminé mais, s’il me précède, il faudra bien l’attraper pour le coucher, l’enfermer sur la page, l’enserrer dans ses paragraphes, le piéger entre deux lignes. Vite avant qu’il ne s’échappe de moi.
« Ouvrir une page. Blanche, elle ne me fait pas peur. »
Le titre vient comme au hasard. Sans jamais prévenir : soudain il surgit ! Il infléchit alors le texte balbutiant, le légitime, le nourrit. Il déclenche avalanche de mots et associations d’idées. Celles-ci s’agglomèrent d’abord, se bousculent, se désordonnent l’une l’autre. Se bordélisent. Elles jaillissent des doigts avant même d’être formulées en tête. Elles jouent les unes avec les autres, se cachent l’une l’autre, se redécouvrent. Elles vont plus vite que moi, cascade fracassante et bruyante qui se déverse sur l’écran. Se rangeant finalement, se triant, s’excluant, elles se ramifient, s’organisent, s’agencent.
L’écriture comme lieu de revendication, écoule un peu de la rage. Elle part de l’affect, le tord sans le broyer, le transforme à coups de signifiants. Bien frappés. En cela elle excite, elle bouillonne, elle brouillonne. En lutte contre la pulsion de mort, le laisser-tomber, la résignation mortifère. Le corps tendu prend sa part ; je n’écris pas avec mes tripes, mais avec le coeur. Ne nous y trompons pas ; pas d’eau de rose ni sensiblerie – le romantisme n’a rien à faire ici. Le corps éprouvé est traversé impérieusement par la puissance du désir d’écrire. Le coeur comme entravé par la pesanteur du texte encore prisonnier, affolé, palpite désordonné, perd son rythme comme tentant en vain d’y échapper. Il faut sortir l’idée mais s’il y a rage, il faut la morceler pour après construire, brique par brique. Poser cartes sur table, mots sur maux, colère sur scandale, férocité sur déception, fureur sur infamie. L’écriture est alors violente, radicale, absolue. Elle voudrait ne rien concéder. Aspirant à la publication, elle doit pourtant rogner et lisser. Un peu. Déplier sans diluer. Elle doit admettre quelques réaménagements lexicaux sans se trahir. Elle est contrainte à quelques concessions. Pour être lisible. Des mots sont écartés quand ils sont trop : violents, radicaux, absolus. J’appelle des synonymes à la rescousse pour voiler – un peu – le dire brut et déchaîné, l’appel à la révolution, l’incitation à la révolte.
« Aspirant à la publication, l’écriture doit pourtant rogner et lisser. Un peu. Déplier sans diluer. Elle doit admettre quelques réaménagements lexicaux sans se trahir. »
La relecture adoucit la matière que l’on voudrait garder rêche, acérée, coupante. La relecture coupe dans la vérité du dire. Elle vient dompter, civiliser, arrondir. Il faut aussi ponctuer et justement. Comme cheffe d’orchestre, imposer le rythme pour s’accorder avec celui du corps qui écrit. Une virgule peut alors faire précipitation en abîme de perplexité. Le point virgule, une délicatesse. J’en userais goulûment si j’osais. Les tirets : la scansion, l’entaille résolue. C’est un travail considérable, la relecture.
Parfois l’écriture ralentit pour venir témoigner de la rencontre, l’accueil de l’autre, le lien fragile ou puissant. Elle aspire alors à la beauté, devient désirante. Elle se pare d’atours, parfois de quelques fioritures, coquetteries dispensables. Mais avant tout, elle déclare solennellement l’altérité comme richesse, comme vitale. Elle sublime la pulsion, poétise l’indicible, magnifie le mot. Elle traque l’instant, la sensation, tourne autour de l’émotion, se plante dans l’intime. Elle enregistre la trace volatile d’une odeur, elle mémorise la couleur, elle fixe pour toujours – on l’espère – l’éphémère.
Mais il faut y revenir : le corps du texte restera toujours à travailler, comme on affine un geste, comme on modèle un muscle. Un mot fait effraction soudain ; comment avait-il pu se faufiler entre les lignes, refoulé de la conscience ? Il est fondamental ! Vite le rajouter, vite lui trouver une place, pousser les autres, ouvrir en-corps la matière, tant pis il y a de l’espace sur la page, tant mieux s’il faut tout reprendre, relire, retravailler, réagencer, changer l’ordre, changer le ton, changer le titre. Y revenir une fois, deux fois, cent fois, tant que le texte continue à vivre en tête, qu’il s’impose en tout lieu et tout temps, tout le temps. Car « ça » s’écrit quand j’étends le linge, « ça » s’écrit quand je lis un livre et « ça » s’écrit quand je cours, podcast à l’oreille. Est alors écrasée la parole de cet autre – l’écriture fait son chemin, elle se fraye partout, à la moindre inattention. Ce qui surgit par surprise chambarde l’ensemble, désorganise le texte déjà écrit, mais il faut rajouter encore ce qui s’impose, ne pas en laisser de côté (pour une autre fois, un autre texte ? non).
« Et tant pis si ça résiste à trouver un bord, une fin. Il s’agit justement de cela : résister. »
Mais il faudra bien le lâcher ce texte, l’expulser de notre tête-à-mots qui pourrait ne jamais trouver fin. Nous évader de la forteresse bâtie comme – paradoxalement – lieu d’émancipation. Déloger l’écrit de l’écran où il est né d’une urgence à dire. Il faudra bien le montrer, imparfait, décevant. L’écriture a trahi la pensée : elle a capturé, elle a collectionné des signifiants ; elle a tenté de s’approcher au plus près mais elle a échoué. Comme toujours. Une certaine fébrilité me saisit. Maintenant il faut aller vite. Frappe chirurgicale, excision rapide. Vite se séparer, vite l’éjecter, vite le jeter dans le monde. Il faudra bien qu’il traverse d’autres corps, ce texte qui n’est plus tout à fait le mien.
Geneviève HENAULT, Psychiatre PH.