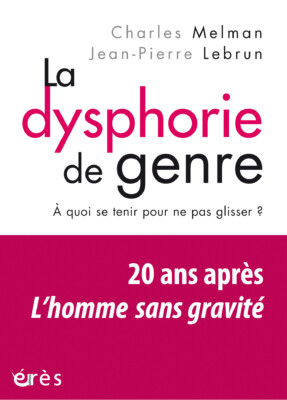Que révèle la dysphorie de genre sur la société d’aujourd’hui ? Est-elle un phénomène de mode et comment la comprendre ? Alors que les cliniciens y sont confrontés sur le terrain, C. Melman et J.P. Lebrun proposent un éclairage sur le sujet.
Cet ouvrage, passionnant dialogue entre les psychiatres et psychanalystes Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun est récemment sorti chez Erès, peu de temps avant le décès du premier et 20 ans après un autre livre de ces deux auteurs qui avait connu un grand succès : « L’homme sans gravité » (Denoël, 2003 ; Folio, essais, 2005).
Une américanisation de la société ?
Les auteurs constatent tout d’abord qu’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents ressentent un grand désarroi par rapport à leur identité sexuée. Le phénomène trouve aux États-unis un écho considérable.
La culture pédiatrique, psychanalytique et pédopsychiatrique française aborde cependant la question de l’identité sexuelle avec mesure, discernement et dans un recours à l’apport freudien et post-freudien, même si l’Œdipe est malade. Cette démarche, moins tape-à-l’œil, a l’avantage de rechercher une solution durablement apaisante et non d’être dans l’efficiency redoutable et irrémédiablement castratrice.
Dans ces situations, les parents ont un rôle essentiel à jouer. Ils sont d’abord éducateurs et ne doivent pas considérer que l’envie ou la lubie de leur enfant doit être systématiquement exécutée.
Cela fait un peu penser à la chirurgie bariatrique et à l’irrémédiable de la castration. Peut-on parler d’identité sexuelle achevée en sachant qu’il existe une bisexualité psychique et que chacun garde dans sa personnalité des traits qui relèvent du sexe qui n’est pas le sien ?
Ce que l’on appelle aujourd’hui « dysphorie de genre » laisse peu ou prou accréditer l’idée que la nature se serait trompée en accordant une âme féminine dans un corps masculin, ou bien l’inverse.
Le ressenti individuel
D’une façon encore plus éclairante et passionnante, Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun partent d’un film, Petite fille (Sébastien Lifshitz, 2020) où la souffrance de l’enfant est imputée à ce qu’il ne pourrait pas obtenir. La dysphorie de genre repose alors la seule conviction qu’un sujet, ici une enfant de 8 ans, qui questionne la réalité de son anatomie. Ainsi l’enfant a de la difficulté à faire le deuil de l’objet entièrement satisfaisant.
Or, il n’y a pas chez l’enfant de désir inné. Il reçoit de son entourage les messages qui vont conditionner son effort de culture et d’accès au symbolique.
De plus en plus de jeunes disent ressentir ne pas être en adéquation avec leur sexe. Certains veulent s’habiller ou se prénommer selon un genre différent de celui « assigné à la naissance ». Ils soutiennent avoir droit à une réponse médicale (thérapie hormonale) voire chercher une réponse radicale du côté de la chirurgie.
Le « ressenti » individuel doit-il obligatoirement faire autorité ? On ne prend plus en compte la réalité génétique qui reste irréductible et inéluctable. Et l’on omet de poser la question centrale : celle de la légitimité d’une telle démarche. Peut-on justifier un droit à des enfants et à des adolescents de changer de genre à partir de leur seul ressenti ? Citons quelques passages :
« Certains placent la demande de l’enfant qui s’affirme “transgenre” sur le même pied que “l’orientation homosexuelle”. Il ne s’agit pourtant pas de la même chose. Il y a une différence radicale entre une attirance vécue dans la réalité de son corps et le fait de vouloir changer de genre à partir de sa seule conviction.
En revanche, il ne faudrait pas qu’au nom de cette interdiction, soit désormais condamnable le simple fait de prêter oreille au questionnement d’un jeune sur son identité sexuée et sur l’opportunité et les risques d’en passer par un traitement hormonal, voire chirurgical ».
On évoque une intime conviction réprimée, mais n’est-ce pas instrumentaliser alors un jeune homme ou un enfant ? Ne devrions-nous pas plutôt nous demander comment il se fait qu’une telle conviction soit devenue aussi fréquente en aussi peu de temps ? Demandons-nous quelle est la part d’autonomie propre et la part d’influence et de pression des jeunes entre eux dans l’éclosion de cette conviction intime ? Quel est le rôle des réseaux sociaux, et celui des associations militantes ? Avons-nous vraiment réfléchi aux effets du changement de genre sur le corps ? L’effet hormonal est irréversible à cause de la dépendance hormonale permanente avec ses conséquences délétères.
La question fondamentale reste bel et bien celle-ci : un enfant souffre-t-il de ne pas obtenir ce qu’il veut, ou souffre-t-il de ne pas avoir été préparé à supporter de ne pas avoir tout ce qu’il veut ?
« Il y a un monde entre prêter l’oreille à une telle préoccupation et la considérer comme une aire de combat où il s’agit de faire gagner une cause ».
Le véritable amour n’est pas inconditionnel. Il est aussi celui donné à la condition d’aider l’enfant à grandir et de lui donner les moyens de trouver sa voie singulière, celle avec laquelle il doit frayer pour atteindre son autonomie. Au nom de quoi la carte d’identité devrait-elle céder devant une identité « à la carte » ?
Une lecture de Dominique BARBIER,
psychiatre, psychanalyste, (Avignon)
- La dysphorie de genre, à quoi se tenir pour ne pas glisser ?, Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun, Ed. Erès, coll. Psychanalyse autrement, janvier 2022, 12 €.