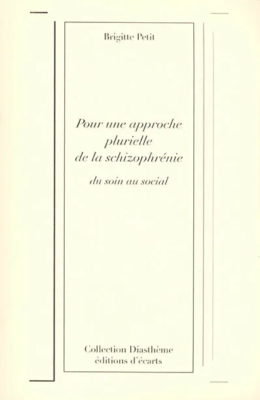Psychologue clinicienne, Brigitte Petit (1) a exercé plus de 40 ans dans des services de psychiatrie adulte. Ses fonctions et des engagements associatifs l’ont amenée à participer à l’élaboration de nombreux projets en lien avec les soins, l’accueil des familles, le médico-social et le social. Dans cet essai, elle partage son expérience et plaide pour une approche plurielle, humaniste, qui laisse une large place à l’intersubjectivité.
Que savons-nous de la souffrance et des troubles de personnes qui, un jour, ont décompensé sur une mode psychotique ? Quelles preuves scientifiques indubitables pourraient corroborer ce choix sociétal de considérer la folie comme une maladie ?
Si la technicité des soins avec son support théorico-clinique est nécessaire, elle ne fait pas tout. Le facteur humain, la relation de confiance, l’écoute sans présupposés qui respecte la singularité du patient, constituent le levier principal du processus de changement thérapeutique.
L’auteur en veut pour preuve, une expérience de 7 ans, en qualité de psychologue clinicienne, dans une unité intersectorielle de patients dits institutionnellement dépendants (des personnes souffrant majoritairement de schizophrénie, hospitalisées depuis de nombreuses années) dans laquelle l’équipe soignante devait mettre en place une clinique singulière de soins et d’accompagnement permettant à ces patients l’élaboration d’un projet de vie hors de l’hôpital. En 5 ans, 47 patients sortiront de cette unité, sans que leur traitement médicamenteux n’ait été significativement modifié. Seules la prise en charge institutionnelle, la psychothérapie et la réhabilitation sociale de chaque patient, au cas par cas, ont opéré le changement souhaité et la réalisation du projet (appartement, famille d’accueil, foyers de vie).
D’où des interrogations qui émergeront au fil de cette expérience particulièrement riche d’enseignement et de partage. Qui sont les patients que l’on qualifie de schizophrènes ? Quels sont ces savoirs que les professionnels revendiquent pour asseoir leurs compétences et leur pouvoir ? Comment se représente-t-on la psychose, le délire, l’étrangeté d’un être singulier et les soins proposés ou imposés ? Qui sont les soignants et quelles sont leurs missions ?
Ainsi, ce livre pose deux grandes questions : la schizophrénie est-elle une maladie ou une manière singulière d’être au monde ? La psychiatrie, le médico-social et le social : quel avenir pour les sujets après une décompensation psychotique ?
La schizophrénie, une maladie ou une manière singulière d’être au monde ?
Pour répondre à la première question, l’auteur répertorie les discours tenus par la science ou les sciences humaines sur le sujet. En effet, il n’existe aucune certitude sur ce qu’est la schizophrénie et les pratiques de soins reposent essentiellement sur des discours plus ou moins éclairés par une discipline scientifique. Ainsi, l’auteur s’est intéressé à différents discours :
— Le discours de la psychiatrie avec une attention particulière portée au diagnostic : comment s’établit-il, à partir de quel corpus théorique, et quels sont les effets de son annonce sur le patient ? L’auteur interroge les notions de normal et de pathologique, comment bascule-t-on d’un côté ou de l’autre ? Symptômes et comportements sont-ils des tentatives pour s’adapter à ce que traverse le patient (le chaos de la psychose décompensée) ou des phénomènes parasites. Le rôle des soignants consiste bien à aider le patient à dégager d’autres manières de réagir à tout ce qui le déstabilise et à le soutenir dans sa recherche de nouvelles normes qui lui seront propres, plus adaptées socialement.
Comme toute discipline médicale, la psychiatrie s’intéresse surtout au corps avec une prédilection pour le cerveau et le système nerveux, au détriment de la pensée. Ainsi la psychiatrie a-t-elle tendance à catégoriser, conceptualiser à l’universel (le cerveau et le système nerveux en général) au détriment des singularités (ce que chacun est individuellement).
Si en médecine somatique, avoir un diabète ou être diabétique n’a pas trop d’incidence, en psychiatrie, être schizophrène bouscule l’identité d’un sujet qui se voit relégué dans un espace stigmatisé. Comment accepter parfois d’être considéré comme schizophrène quand sa propre identité vacille dans la souffrance d’une décompensation et lorsqu’on connaît la stigmatisation dont on sera l’objet dans nos sociétés ?
En psychiatrie, le diagnostic ne repose pas sur des critères objectifs comme une prise de sang ou une radiographie mais sur des comportements repérés par le médecin. Et dans ces comportements repérés comme pathologiques, il y a toujours du « trop » ou du « pas assez » dans des comportements qui sont par ailleurs courants, partagés par tout le monde : la colère, la peur, l’évitement, l’excitation, l’abattement, etc. (Trop, pour l’agitation, la dispersion, les propos étranges, etc. et pas assez pour le manque d’ouverture aux autres, le repli sur soi). Et qu’est-ce qui établit la limite entre le normal (tous les comportements des patients) et le pathologique (le trop ou pas assez) ?
— Le discours des laboratoires pharmaceutiques : le succès des laboratoires pharmaceutiques tient aux découvertes faites, souvent par hasard, de certaines molécules qui ont le pouvoir d’abraser des symptômes comme l’excitation ou la dépression, ou bien d’atténuer l’angoisse. Les psychotropes soignent en diminuant les effets gênants mais ne guérissent pas. Si autrefois ils servaient à réguler la symptomatologie pour rendre le patient accessible à d’autres prises en charge thérapeutiques, aujourd’hui, ils deviennent la pierre angulaire du soin, grâce à l’hypothèse dopaminergique de la psychose. Mais une décompensation psychotique ne peut pas être considérée exclusivement comme un excès de dopamine qu’il conviendrait de baisser par les psychotropes. Si le traitement médicamenteux est important, il n’est pas suffisant.
— Le discours de la génétique : nous n’en finissons pas de traquer le gène de la schizophrénie sans jamais le saisir. Chercher exclusivement dans le corps, qui plus est, dans ce qu’il y a de plus biologique dans l’être humain, c’est-à-dire son patrimoine génétique caché au sein de ses cellules, l’origine d’une maladie qui prend sa source dans le lien à l’autre, est curieux. Il paraît plus intéressant de revenir à la notion d’hérédité et non de transmission génétique, parce que l’héritage ne concerne pas seulement nos gènes mais aussi notre histoire, celle de nos ascendants, la nature de l’environnement, etc.
— Le discours des neurosciences : les neurosciences ont bénéficié de méthodes d’investigations performantes (l’IRM) leur permettant de voir ce qui ne se voyait pas auparavant. Mais que déduire de ce que l’on voit ? L’image ne suffit pas. Des corrélations entre des réseaux complexes de circulation d’informations, en action, ne révèlent pas forcément des causalités. Ainsi pour expliquer la psychose, sommes-nous passés en deux siècles de lésions invisibles du cerveau avec dysfonctionnements du système nerveux, à des anomalies génétiques, puis à des vulnérabilités et des déficits. Toute difficulté, tout obstacle pour un patient dans une tâche à accomplir est mis sur le compte d’une défaillance ou d’une anomalie de fonctionnement touchant son cerveau. Mais l’angoisse, le manque de confiance en soi provoquent également ces difficultés.
— Le discours de la psychanalyse : elle s’intéresse plus au sujet souffrant de schizophrénie qu’à la schizophrénie. Le fait qu’une personne soit unique est au cœur de ses préoccupations, non le sujet universel. Son intérêt se porte sur la manière dont le sujet organise son monde interne (son psychisme) et négocie avec la réalité.
Si l’éthique de la psychanalyse tend vers la prise en compte de la singularité de la personne sans présupposé, elle en oublie parfois ses principes concernant le sort réservé aux familles de patients psychotiques, rejetées par les institutions de soins et à l’endroit desquelles certains psychanalystes tiennent des discours culpabilisants voire caricaturaux (la mère phallique, castratrice, le père défaillant).
— Le discours des patients sur eux-mêmes à travers leurs témoignages et leurs réflexions.
Dans une conclusion partielle, l’auteur répond à cette première question : la schizophrénie est-elle une maladie ou une manière singulière d’être au monde ? La schizophrénie est une maladie psychique qui ne correspond qu’à la phase active de la décompensation, si bien décrite par les patients eux-mêmes. Dans le sens d’une structure psychotique, un sujet peut être schizophrène sans être « malade ».
La schizophrénie dans la littérature et les arts
L’auteur poursuit sa réflexion sur l’importance de la littérature qui apporte un éclairage précieux sur ce qu’est la folie en offrant une autre grille de lecture du comportement des êtres humains et de leur intimité. Grâce à la lecture, chaque lecteur glisse progressivement dans l’univers social, historique et intime de personnages qu’il suit dans le déroulé d’un épisode de leur vie. Ces personnages le touchent par ce qu’ils sont et par ce qu’ils révèlent en lui, lecteur en attente de quelque chose. Dans ces livres, combien de personnages seraient catalogués en psychiatrie, schizophrènes, bipolaires, paranoïaques, état-limites ? La littérature ouvre à l’inconnu ou l’inattendu et enseigne au passage bien des vérités sur la nature humaine. Mais lorsque que ce lecteur devient professionnel d’un service de psychiatrie, il ne perçoit pas les mêmes choses, parce que l’institution l’oblige à porter un certain regard, axé sur le pathologique, afin de remplir ses missions.
Le domaine des arts semble apporter aux sujets schizophrènes un havre de paix et de reconnaissance sociale. Sans doute, parce que l’art s’intéresse avant tout à l’expression de l’être, à ses émotions et à sa subjectivité dans ce qu’elle peut produire comme figures de vérité.
Quel avenir pour les sujets après une décompensation psychotique ?
La deuxième question concerne la psychiatrie, le médico-social et le social : quel avenir pour les sujets après une décompensation psychotique ?
L’auteur prend comme fil conducteur de cette deuxième partie, le moment de la décompensation psychotique, ce moment où tout bascule pour un sujet qui, malade de ses troubles, fait connaissance avec la psychiatrie. Dans quel univers pénètre-t-il, que peut-il attendre des soins qui lui seront apportés ? Et comment sera-t-il accueilli ?
La manière de se représenter les troubles psychiques dont souffre une personne est importante et produit des effets dont certains ne sont pas attendus ou échappent aux soignants. En effet, l’absence de savoir précis sur la psychose autorise des savoirs multiples, parfois contradictoires, ainsi que des techniques qui mélangent théories et sens commun. Comme personne ne sait ce qu’est réellement la psychose, chaque soignant s’en façonne une représentation à partir de bribes de savoirs et de son expérience professionnelle. D’où le poids des représentations sociales dans la conception des soins et dans le choix des concepts qui guideront les pratiques, expliquant la diversité des cultures de soins et de leur exercice, d’un secteur psychiatrique à l’autre.
L’auteur aborde ensuite les missions complexes et contradictoires de la psychiatrie. Comment un arsenal juridique et administratif de plus en plus lourd s’infiltre dans les soins avec un souci de cohérence qui fait parfois défaut. La psychiatrie ne fait pas que soigner : elle gère. Et l’Etat, à travers ses différents échelons de pouvoir et de contrôle, n’en finit pas de lui demander des comptes. Depuis les années 2000, l’hôpital se voit traité comme une entreprise privée avec les mêmes injonctions de rentabilité. Cette pression de compétitivité, qui ne cesse de pressurer les soignants, a des effets insidieux sur leurs pratiques de soins. Soigner côtoie parfois la nécessité de gérer un flux de patients de plus en plus important à moyens constants. Les soignants recourent alors à de nouvelles pratiques qu’ils justifieront, non à partir d’une réalité administrative qui est de libérer des places, mais par une évolution « modernisée » des soins, encouragée par les politiques gouvernementales qui en promeuvent le concept : le virage ambulatoire qui s’applique à toutes les disciplines médicales, permettant le transfert des soins de l’hôpital au domicile. La durée moyenne d’hospitalisation, complète ou séquentielle, doit donc diminuer pour tous les patients, qu’ils soient en situation de dépendance physique suite à une intervention chirurgicale ou en détresse psychique, confrontés à une solitude abyssale.
Dans le chapitre le soin psychiatrique, un défi sans cesse à relever, l’auteur évoque comment l’organisation des soins, la naissance et la gestion du collectif soignant sont à la fois complexes et essentielles. Conserver une ambiance institutionnelle sans trop de tensions, répondre aux besoins de chaque professionnel afin qu’il réalise ses tâches, l’obligation de travailler ensemble et de se soutenir sont, au sein d’un service, les véritables défis à relever au quotidien. Les infirmiers occupent une place majeure dans le dispositif de soins parce qu’ils accompagnent, 24h/24, le patient dans sa restauration psychique. Par leur présence continue et leur compétence, ils offrent aux patients le matériel psychique dont ils ont besoin pour se reconstruire et apportent la réassurance nécessaire permettant d’endiguer leurs angoisses.
L’accueil en service hospitalier
Puis vient la rencontre du sujet schizophrène avec la psychiatrie en prenant comme point de départ le moment de la décompensation psychotique et l’admission dans un service hospitalier. L’accent est mis sur le vécu du sujet à ce moment-là.
L’auteur met en lien l’expérience de décompensation, telle que la rapportent les patients avec l’accueil dans un service hospitalier, les soins et l’accompagnement proposés ou imposés. Des apports théorico-cliniques viennent éclairer ce que le patient traverse. Sont également analysés thérapies institutionnelles, médiations thérapeutiques, psychothérapies, remédiations cognitives et ateliers de réhabilitation psychosociale. Mais aussi les associations soignants-soignés ou les clubs thérapeutiques, associations loi 1901 qui promeuvent l’égalité de traitement de leurs membres, qu’ils soient patients ou soignants.
L’accompagnement post-hospitalisation
L’auteur interroge la place des familles dans les services de psychiatrie, ce qu’elles vivent et comment les professionnels les accueillent. A leur sortie d’hospitalisation, 75 % des patients sont accompagnés quasi quotidiennement par leurs parents et la moitié vit sous leur toit. Ainsi, les familles occupent-elles une place importante dans l’environnement social du patient. L’auteur rappelle, qu’en tant que soignants, nous n’avons que deux leviers pour aider les patients à retrouver un équilibre psychique suffisant pour leur permettre de déployer leur parcours de vie : ce que l’on peut mobiliser psychiquement chez eux en termes de changement et d’adaptation et ce que l’on doit aménager à l’extérieur, dans leur environnement social, pour en favoriser l’accès.
Puis, toujours dans le souci de suivre le patient à sa sortie d’hospitalisation, l’auteur poursuit sa réflexion sur l’accompagnement dans le secteur médico-social des personnes qui ont besoin, après une décompensation psychotique, de structures d’accueil ou de dispositifs aidants, pour un temps donné ou à plus long terme. Le transfert accéléré de patients relevant de soins spécialisés en service de psychiatrie dans des structures médico-sociales où le soin n’est plus de même nature, invite à s’interroger sur l’adaptation et la culture d’accompagnement de ces dernières, à l’endroit de la psychose ou plutôt de l’après décompensation.
L’auteur a pu observer la manière dont les professionnels socio-éducatifs de ces structures se positionnaient face aux résidents et en tirer enseignement. Ces rencontres avec le médico-social ont également permis de préciser les définitions conceptuelles du soin et de l’éducatif. La propension du sanitaire est parfois, voire souvent (selon les unités de soins), de privilégier l’éducatif dans la prise en charge, au détriment du soin.
L’intégration sociale sous différentes formes est évoquée : logement, travail, études, loisirs, associations, avec un point d’attention sur la dynamique des Groupes d’Entraide Mutuelle.
L’auteur aborde la démocratie sanitaire à travers sa participation, pendant 6 ans, au groupe de travail permanent Psychiatrie et Santé mentale de la Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA) des Pays-de-la-Loire qui est l’organe par excellence de la démocratie sanitaire des Agences Régionales de Santé (ARS). Il témoigne de la manière dont sur le terrain, cette démocratie sanitaire à l’endroit des usagers est mal accompagnée, peu créative, avec toujours cette tentation d’en favoriser l’accès dans les marges du fonctionnement, sans remettre en cause les instances qui sont censées la mettre en place.
Dans sa conclusion, l’auteur répond au besoin de terminer ce travail par un autre discours que scientifique, psychologique ou psychanalytique. Un besoin de parler du sujet autrement, de le voir dans sa vérité d’être humain aux prises avec la difficile condition humaine.
Une lecture de Michèle Hucorne, psychologue clinicienne
1– B. Petit a été déléguée régionale Pays de la Loire de la Fédération d’aide à la santé mentale Croix Marine pendant 4 ans, membre du groupe permanent Santé mentale et psychiatrie de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé (ars) des Pays de la Loire pendant 6 ans. Elle assure le parrainage du Groupe d’entraide mutuelle (GEM) de Nantes, est membre de l’association de familles de patients psychotiques adultes Pas à pas.
- Brigitte Petit, Pour une approche plurielle de la schizophrénie. Du lien au social, Ed. D’écards, Coll. Diasthème, juin 2022