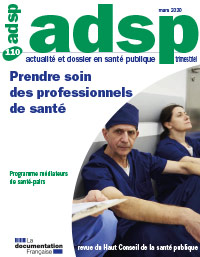Publication du n°104 d'Actualité et dossier en santé publique (adsp) sur la santé des personnes sous main de justice
En publiant l’avis sur l’évaluation de la stratégie santé des personnes placées sous main de justice, le Haut Conseil de la santé publique a rappelé que ces personnes devaient bénéficier de la logique globale de la stratégie nationale de santé, privilégiant la promotion de la santé, la prévention, la lutte contre les inégalités d’accès aux soins, la qualité de ces soins, leur sécurité et leur pertinence. Dire que les états de santé conditionnent la réinsertion des personnes placées sous main de justice est une évidence. Il s’agit donc de leur garantir un accès aux soins équivalent à celui dont bénéficie par principe la population générale. Cela implique, si la population sous main de justice est exposée à des risques spécifiques, qu’ils soient identifiés, que l’information soit connue, et que la réponse apportée soit adéquate.
Longtemps on a parlé de la santé des seuls détenus sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire. L’expression « personnes placées sous main de justice » élargit la focale et englobe toute « personne confiée » aux services de la justice, selon le terme choisi par l’administration en charge de la protection de la jeunesse.
De la petite délinquance à la détention, d’un suivi en milieu ouvert aux mesures préventives, du jugement à la condamnation, de la maison d’arrêt au centre de détention, du contrôle judiciaire aux travaux d’intérêt général, de la liberté conditionnelle au placement externe, il existe toute une de série de situations, de lieux de vie, de mesures judiciaires dans lesquels la santé des personnes varie. Deux fois plus nombreuses que les personnes écrouées, les personnes non détenues mais sous main de justice ont des histoires de vie et donc des états de santé qui peuvent différer de la population générale.
Ce travail d’analyse est décrit par plusieurs auteurs dans la première partie de ce dossier. On y retrouve le cumul des conditions péjoratives pour la santé en lien avec le gradient social, et donc des pathologies comparables à celles de la population générale majorées par un retard de leur prise en charge. Eu égard à la plus grande prise de risques pour la santé physique et mentale, à la plus grande consommation de substances nocives, mais aussi à la récurrence des expositions à des environnements défavorables, certaines pathologies, comme les infections transmissibles, les addictions, les troubles psychiques sont plus fréquentes. Considéré isolément, le risque suicidaire est majeur, avec un taux de suicide multiplié par sept par rapport à la population générale. Survenant surtout dans les premiers temps d’incarcération mais également dans la période qui suit la libération, ces événements sont plus liés au parcours judiciaire et pénitentiaire qu’aux facteurs individuels. Les jeunes majeurs ou mineurs proches de la majorité font l’objet de mesures spéciales compte tenu de leur vulnérabilité. Dans ce contexte, l’objectif de promotion de la santé prévu par la stratégie de santé, qui requiert participation des usagers et environnement favorable, prend une tonalité particulière.
Des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour permettre le passage entre les services de l’administration judiciaire et l’administration de la santé afin de rendre possible le suivi des questions de santé, dans les conditions normales de respect de la dignité du patient et de la confidentialité des soins. En pratique, les associations qui interviennent en lieu de détention comme en milieu ouvert constatent que ces principes sont difficiles à conserver en raison des objectifs souvent contradictoires des deux administrations.
Certaines expériences étrangères ouvrent quelques voies. C’est le cas de l’Angleterre et de l’Irlande du Nord, qui s’appuient sur le nombre de récidives pour justifier la coordination des parcours de soins et la collaboration étroite entre les services de santé, les services de réinsertion et l’ensemble des services sociaux.
Le terme même de privation de liberté implique, pour les personnes concernées, une révision des modes de vie et donc de l’intimité, de l’autonomie, de la sécurité et de la vie relationnelle. Ce constat, renforcé par un argumentaire sur les droits humains et par des enquêtes ethno-anthropologiques sur la vie en détention, alimente la réflexion sur les modes de punition des conduites délictueuses dénoncées par nos sociétés. La dégradation des états de santé et la majoration des pathologies n’entrent pas dans la catégorie des sanctions. À ce titre, toute observation en ce sens est une mise en garde contre un transfert de peines qui serait en complète opposition avec l’esprit des actions édictées depuis plusieurs décennies pour la santé des personnes placées sous main de justice.
Adsp n°104, Santé des personnes sous main de justice, 56 pages, 18€, vente en librairie