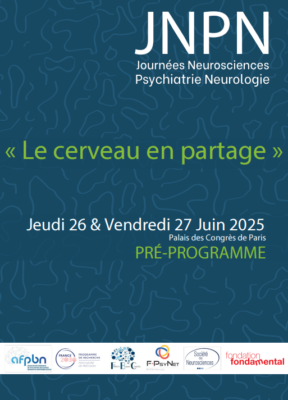Journées neurosciences psychiatrie neurologie 2025, organisées les 26 et 27 juin 2025 en partenariat avec l’Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie (AFPBN), le Congrès français de psychiatrie et la Fondation Fondamental.
Avec l’essor de nouvelles technologies et la multiplication des études sur les interfaces cerveau-machine, la neurogénétique et les approches psychothérapeutiques, les domaines de la psychiatrie et de la neurologie se redéfinissent. Jamais les ponts entre ces disciplines n’ont été aussi nombreux ni les perspectives aussi prometteuses pour offrir aux patients une meilleure qualité de vie, de nouveaux traitements et un espoir renouvelé.
Ces journées symbolisent cet esprit : un rendez-vous qui met la recherche et l’innovation au service de la pratique clinique pour repenser les diagnostics et les thérapies. C’est également un moment privilégié pour renforcer cette communauté scientifique et professionnelle. Que vous soyez spécialiste expérimenté, jeune chercheur ou clinicien en devenir, votre contribution est essentielle à la dynamique collective qui anime ces journées.
Au cœur de la capitale, cet événement réunira experts, chercheurs, cliniciens et étudiants pour deux jours d’échanges intenses, d’apprentissage et de découvertes d’innovations autour des avancées neuroscientifiques, psychiatriques et neurologiques.
Au programme de cette édition 2025 :
L’arrêt des traitements dans les maladies chroniques : regard croisé sur la sclérose en plaques et la schizophrénie :
Pendant longtemps, le maintien d’un traitement au long cours a été considéré comme une stratégie incontournable pour éviter les rechutes dans des pathologies chroniques et évolutives comme la sclérose en plaques et la schizophrénie.
Ces deux maladies, bien que distinctes, partagent des similitudes : un âge d’apparition précoce et une évolution complexe nécessitant une prise en charge adaptée.
Mais aujourd’hui, les recommandations évoluent. De plus en plus de spécialistes s’interrogent : est-il toujours nécessaire de maintenir ces traitements indéfiniment ? Peut-on, dans certains cas, envisager une réduction progressive, voire un arrêt ? Quels en seraient les bénéfices et les risques ?
Nous allons explorer les facteurs qui motivent cette nouvelle approche, les enjeux communs et spécifiques de la déprescription dans ces deux pathologies et les perspectives qu’elle ouvre pour les patients et les soignants.
Les sciences du cerveau et des comportements sont aujourd’hui à un tournant. Pierre-Michel Llorca, président du comité scientifique de ces journées, vous souhaite à tous de fructueux échanges et des découvertes passionnantes.
Rens. : www.jnpn-paris.com