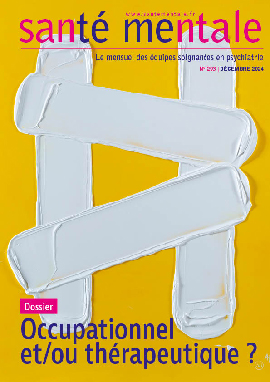Mis en place par la loi de 1838 (1), les asiles psychiatriques français étaient conçus pour être des lieux d’enfermement (le « grand renfermement » selon Michel Foucault (2)), sur une longue durée. On pouvait y passer une vie entière. Camille Claudel, à sa manière, est la figure emblématique de tous ces reclus, exclus, que leur maladie a isolés et laissé face à eux-mêmes durant un temps infini. Pressée de continuer à créer par les médecins aliénistes qui l’ont suivie, d’abord à Mondevergues-les-Roses puis à Montfavet en novembre 1914 jusqu’à sa mort en 1943, dans le contexte des terribles privations engendrées par la Seconde Guerre mondiale, elle a toujours refusé de se (re)mettre à son art, la sculpture. Elle est morte seule, sans avoir occupé son temps à créer. Camille Claudel est morte en tant qu’artiste dès son entrée à l’asile d’aliénés. Dans les asiles d’alors, lieu de vie et de soin étaient confondus. On vivait là où on était soigné, on était soigné là où on vivait.
En 1952, l’avènement des psychotropes (la chlorpromazine) a constitué une formidable révolution culturelle en psychiatrie. Grâce aux médicaments, les symptomatologies les plus bruyantes étaient contenues, atténuées, apaisées. Jusqu’alors les patients tournaient en rond, vacants dans leurs têtes, soumis à leurs délires, ce qui posait peu de dilemmes aux soignants. Mais une fois calmés, plus disponibles psychiquement, il a fallu les occuper.
En parallèle, l’essor de la psychothérapie institutionnelle, née durant la Seconde Guerre mondiale sous l’impulsion de psychiatres résistants puis militants, a ouvert des perspectives nouvelles, fondant un pan de la psychiatrie sociale. De lieu d’enfermement, l’hôpital psychiatrique a eu pour vocation de devenir lieu de thérapie et de (re)socialisation.
Pour poursuivre votre lecture
Connectez-vous à votre compte si vous êtes déjà client.