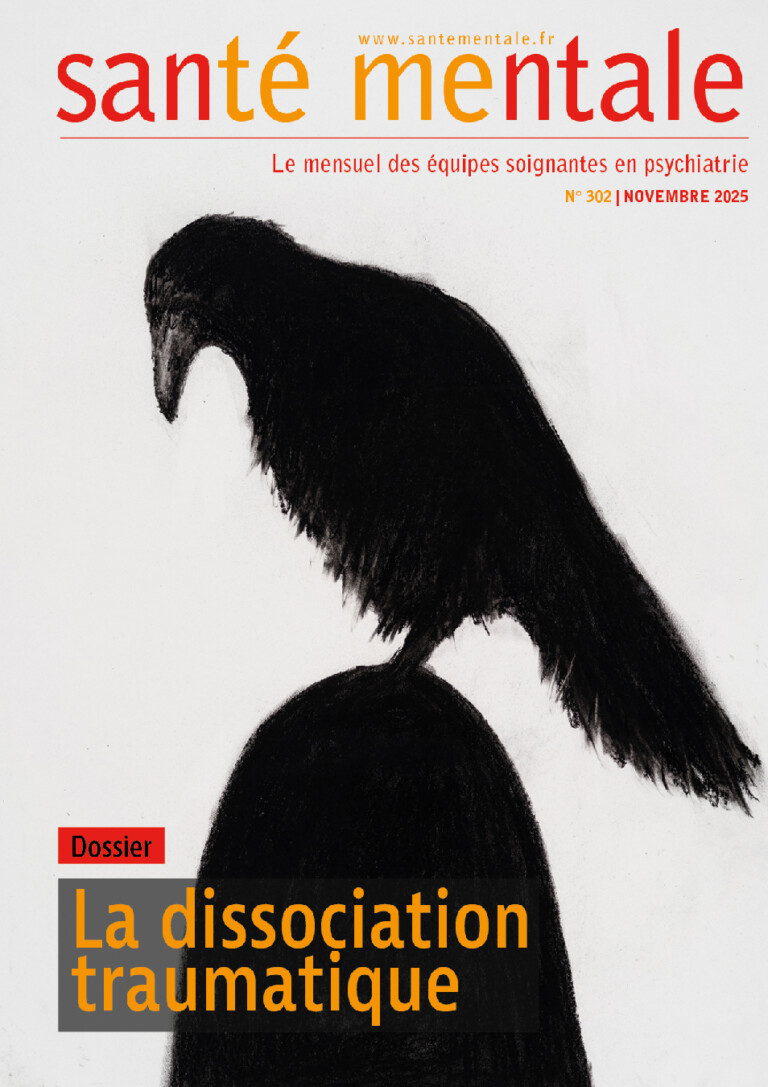Ce jour-là, la médecin généraliste de l’unité longue durée croise à nouveau Madame U. qui s’obstine à changer ce qu’elle a, ce qu’elle est. Mais aujourd’hui il s’agit d’autre chose. Ce qu’elle veut changer, c’est l’endroit où elle est. Un désir d’ailleurs. L’intime conviction, soudaine, éphémère, urgente et vitale, qu’elle doit partir d’ici. Aller vivre ailleurs. Vivre…
« Je vais partir en voyage, moi. Je sais pas. Je veux partir en voyage. Je vais aller au Cap Vert. Ou au Sénégal. »
Il y a chez Madame U. (1) des élans vitaux d’une grande intensité, à la mesure du marasme qu’elle combat, une tristesse infinie, un narcissisme fragile, une blessure jamais refermée. J’ignore si l’importance particulière qu’elle accorde à son apparence est antérieure à sa mastectomie, ou si cette dernière a mis l’apparence au cœur de ses préoccupations. Mastectomie, un bien vilain mot. L’une de mes amies affirme que certains mots sont rugueux. Qu’ils donnent la nausée. Je gage que mastectomie est l’une de ces mots.
« J’aime bien les paillettes »
Depuis mon arrivée dans l’unité, elle n’a pas eu de problèmes particuliers à traiter avec moi. Des dépistages, des vaccins : reprendre le suivi de ce cancer du sein qui l’a tant affectée.
Je la croise dans le parc, ou dans l’unité. Je la salue, j’échange souvent quelques mots avec elle, qu’elle sache que je suis là. Et chaque fois, c’est une nouvelle pulsion qui l’anime, un nouveau désir soudain de quelque chose, un nouvel objet d’apparat, une nouvelle fantaisie capillaire. Quand ce ne sont pas les épaules chargées de malheur, c’est le visage défait d’une Madame U. qui erre. Mais alors il est impossible d’accrocher son regard. Elle passe, sans lever les yeux de ses pieds.
Madame U. me complimente souvent sur mon apparence. Sur un détail de mon style vestimentaire, pourtant rudimentaire, et à demi dissimulé dans ma blouse, sur ma minceur. Je sens comme une forme d’envie qui émane d’elle, souvent. Sans haine apparente, sans élans agressifs, car ce n’est pas moi particulièrement qu’elle envie. L’envie d’être une autre est nichée au creux de son ventre, comme une autre tumeur qui aurait remplacé la sienne.
Je la salue un matin dans le couloir. « Bonjour Madame U. Que de paillettes aujourd’hui ! », fais-je remarquer, devant l’assortiment des strass de son t-shirt bariolé, à son ombre à paupières irisée. « Oui, j’aime bien les paillettes. »
Elle marque une pause. À nouveau, cet effondrement soudain, le sourire qui s’éteint.
« Ça ne me va pas. Si ? Il y avait une fille. Elle avait un t-shirt à paillettes. Le même t-shirt. Ça lui allait bien. Elle était mince. Moi ça ne me va pas. Je ne suis pas belle.
– Au contraire, je trouve qu’il vous va très bien, moi. Vous n’avez pas besoin d’être une autre.
– Ah bon ? Vous trouvez… »

Une autre fois, ce sont ses cheveux qui la préoccupent. Elle a vu une femme, avec une autre coupe, elle veut la même. Elle serait prête à changer tout ce qu’elle a, tout ce qu’elle paraît, pour changer ce qu’elle est.
Mais aujourd’hui, il s’agit encore autre chose. Ce qu’elle veut changer, c’est l’endroit où elle est. Un désir d’ailleurs. L’intime conviction, soudaine, éphémère, urgente et vitale, qu’elle doit partir d’ici. Aller vivre ailleurs. Vivre.
« Rester, c’est exister. Mais voyager, c’est vivre. »
Cette phrase de Gustave Nadaud (2) me revient en tête. Une phrase que je me murmurais trois ans plus tôt à l’aéroport, ancrée sous un sac à dos de dix kilos, et pourtant jamais je n’avais été si légère. J’étais à l’aube d’un tour du monde qui devait durer six mois pour me guérir des traumatismes répétés de mes études de médecine et d’un chagrin d’amour qui sonnait alors pour moi comme une myocardectomie. Je ne doutais pas une seconde alors que le voyage ferait disparaître cette sensation de vide atroce, cette douleur lancinante qui me dévorait depuis presque un an. Que j’arrêterai enfin de pleurer. Et la douleur était revenue, quelques jours avant le retour à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, elle était là. Pour deux ans encore, elle serait là, comme une identité.
« Je vais partir en voyage, moi. Je vais partir. Je dois partir. »
Une empathie profonde me serre le cœur. Quand on ne peut combattre le mal, comme il devient urgent de le fuir. De s’arracher à la folie, à la dépression. Qui sait, peut-être qu’elle aurait, comme moi, un temps de répit ? Si sa peine est lourde, et lente, il lui faudra des mois pour arriver jusqu’au Cap Vert et la rattraper. Autant de mois de sursis.
« Ma folie me rend immortel. Je peux choisir d’être une libellule, qui ne craint pas la mort parce qu’elle est bleue et rapide, et que la mort est lente et noire. Mais si toutefois la mort me rattrape, je disparais dans le sol et je reparais en Chine, où le soleil brille et où la mort n’est pas encore. »
Une phrase de mon frère, cette fois, de ses premiers écrits.
Pulsion contre pulsion, la vie contre la mort, c’est Madame U. qui s’efforce de sourire.
Vanawine Sylviery
Médecin généraliste
1– Voir aussi l’article « Je n’arrive plus à sourire » de la même autrice
2– Nadaud G (1820-1893) A du texte. Contes, scènes et récits / par Gustave Nadaud,… [En ligne]. 1886 [cité le 4 nov 2021]. Disponible : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54933d