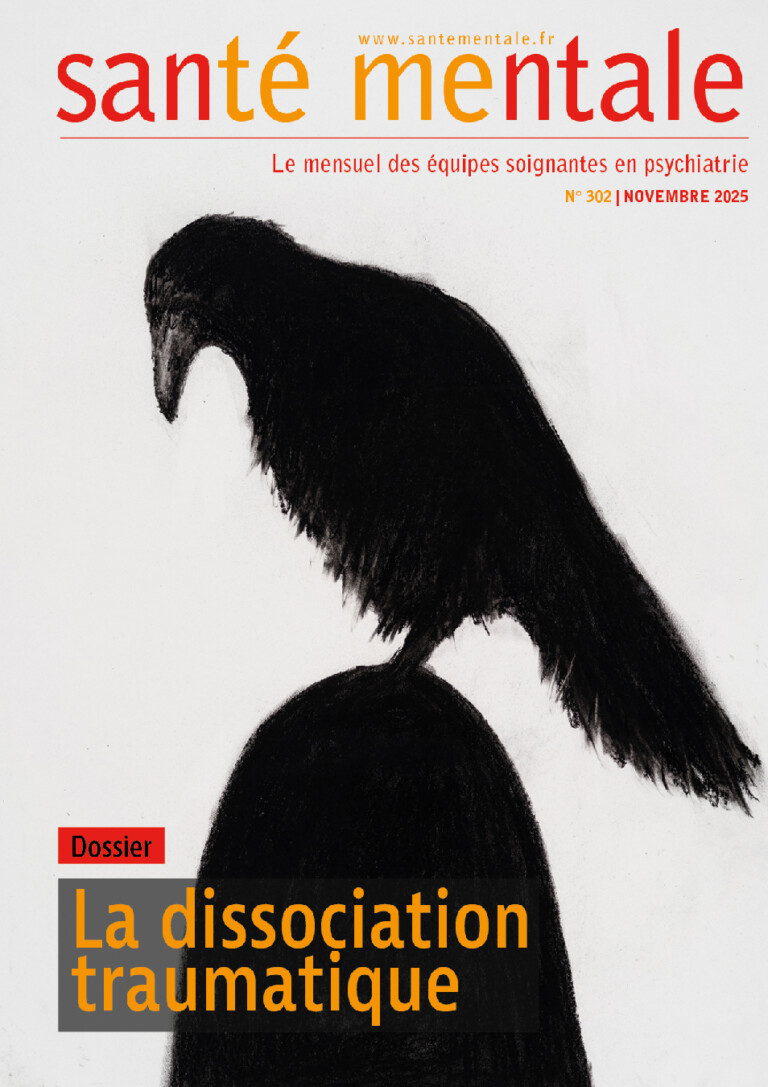Manque de moyens, lieux vétustes, pénurie de médicaments, difficultés à obtenir des rendez-vous, équipes surchargées et désabusées… Comment travailler dans des conditions si dégradées ? Quand le énième obstacle surgit, le vase déborde. La généraliste V. Sylviery évoque son épuisement.
« … porter des sous-vêtements en coton, bien boire dans la journée, ne pas vous retenir d’aller aux toilettes… et peut-être que vous pourriez passer à deux douches par jour au lieu de quatre, pour commencer ? Au moins, ne pas utiliser de savon directement sur les muqueuses…
– D’accord Docteur, je vais essayer. C’est vrai, j’ai remarqué que je ne bois pas assez d’eau. »
J’interviens ce matin-là en unité d’entrée. Tandis que je cherche de quoi réaliser une bandelette urinaire à Madame D., pour sa quatrième cystite de l’année, je ne trouve plus de Dakin nulle part. Je demande à une infirmière. Elle cherche aux mêmes endroits que moi. N’en trouve pas non plus. Me dit qu’elle ne sait pas. S’en va.
Hier c’était l’otoscope qui restait introuvable. Avant-hier c’était le drap d’examen qui manquait. Et me voilà obligée de donner un tube de bétadine gynéco à Madame D., à qui je viens d’expliquer qu’il ne faut pas se décaper les muqueuses avec du savon. Tandis que je la raccompagne, elle me remercie pour mon temps et pour les solutions apportées.
Je reçois Madame F. Pendant la consultation, alors qu’elle essaie péniblement de me parler de son viol, trois personnes entrent dans la pièce sans frapper. Un livreur de la pharmacie, qui pose ses paquets, ressort sans fermer la porte. Une infirmière vient préparer ses traitements : elle traverse trois fois le box, ressort, laisse la porte ouverte. Une étudiante, qui vient utiliser l’ordinateur, reste là.
Car, oui, la pièce où je reçois les patients, celle où se trouve la table d’examen, sert aussi de pharmacie, de salle de préparation, de salle de stockage, de salle de soin, de poubelle.
Je raccompagne Madame F., qui me remercie pour mon aide. Je croise Monsieur R. Je l’aime beaucoup. D’abord parce qu’il ne mange pas d’animaux. Ensuite parce qu’il me parle toujours d’une voix très douce, comme s’il avait peur de m’effrayer. Et je sais d’après mon collègue généraliste des urgences qu’il peut être tout à fait effrayant avec d’autres, lorsqu’il est contrarié. Enfin, parce que je l’ai surpris un jour dans le parc, assis dans l’herbe près d’un arbre. Il tendait son visage et ses yeux clos aux rayons du soleil, l’air serein et apaisé. Avec ses immenses cheveux qui lui tombent aux genoux, il avait l’air d’un chaman en train de méditer. Et j’avais envie, plutôt que d’aller travailler, de venir m’asseoir près de lui et de, moi aussi, faire le plein de vitamine D.
Je lui fais remarquer que ses yeux vont mieux depuis le traitement qu’on a débuté. Il confirme, me remercie pour tout le temps que je lui ai consacré hier, pour ma gentillesse. Il me dit, en s’excusant, qu’il n’a pas encore eu la pommade que je lui avais proposée pour ses pieds. J’interroge Thibault, l’aide-soignant. « Je ne sais pas, il faut demander aux infirmières, et elles sont pas là. » C’est toujours comme ça. Je prescris des vitamines, des vaccins, des crèmes. Et les jours passent, et les patients me demandent pourquoi ils ne les ont pas. Et tous ne sont pas aussi polis que Monsieur R. lorsqu’ils sont frustrés. Alors j’essuie les remarques et les reproches, je demande aux équipes d’un air désolé, puis fatiguée, puis excédé. Je suis de moins en moins la bienvenue, à force d’avoir à demander.

Des combats désespérés ?…
Je retourne dans la salle de soins. Je m’assois sur la table d’examen. Je fixe le mur devant moi. Les minutes passent, et je remarque à peine une larme qui s’écoule le long de ma joue. Un seul Dakin vous manque et le monde s’effondre.
Je crois que c’est le poids du décès de Madame C. qui s’abat sur moi (Tombée en automne…). Le pavé qui fait déborder le vase. Madame C., pas une amie, juste une patiente, et même pas une de celles avec qui j’ai pu particulièrement me lier. Peut-être qu’en dix mois d’approche, j’ai fini par m’y attacher. Peut-être simplement que je ne supporte plus de voir mes patients être les fusibles explosés du système hospitalier en berne dans lequel je surnage. J’ai l’impression de me noyer.
Je me lève. C’est déjà midi, Emile, pas vrai (Le temps de bien travailler…) ? Je me faufile hors du service, rase les murs jusqu’à mon bureau. Je n’ai pas peur des autres. Mais je n’ai pas envie de leur parler.
Je m’enferme à clé. Je mange seule.
Je pourrais aller retrouver mes collègues généralistes. Je les aime, mes collègues, et je les admire de tenir bon. Mais il faut se composer une mine, dire que ça va, ne pas plomber le moral des troupes fatiguées. Ou même si l’on se plaint, tous ensemble, de combattre désespérément, d’endurer les mêmes souffrances, il faut le faire avec retenue. Sans qu’à la fin, personne n’a trouvé un quelconque réconfort dans ce constat alarmant auquel on ne peut rien changer.
Et aujourd’hui, je n’ai pas envie. Je n’ai pas la force.
Dans l’après midi, je prescris le sachet d’antibiotique recommandé en cas d’infection urinaire simple à Madame D., dont la bandelette est positive. J’envoie un mail à toute l’équipe pour les prévenir, je sais que sans cela, ça ne sera ni commandé ni administré. Le lendemain, je découvre un mail la concernant: « Madame D. a des brûlures mictionnelles. Elle n’a pas d’antibiotique. Pourriez vous l’examiner ? »
J’ai l’impression de brasser de l’air, de me démultiplier, d’examiner, d’organiser, de prescrire, d’adresser, à tour de bras. Et quand je reviens sur mes pas, c’est toujours la même déception. Les rendez-vous ne sont pas pris. Les traitements ne sont pas administrés. Les patients ne sont pas contents. Les équipes sont débordés.
Et moi, je suis épuisée…