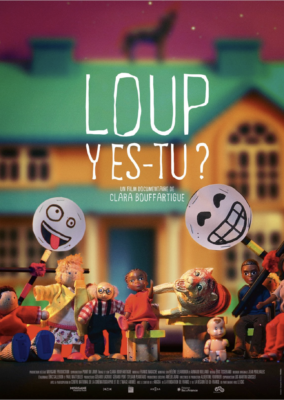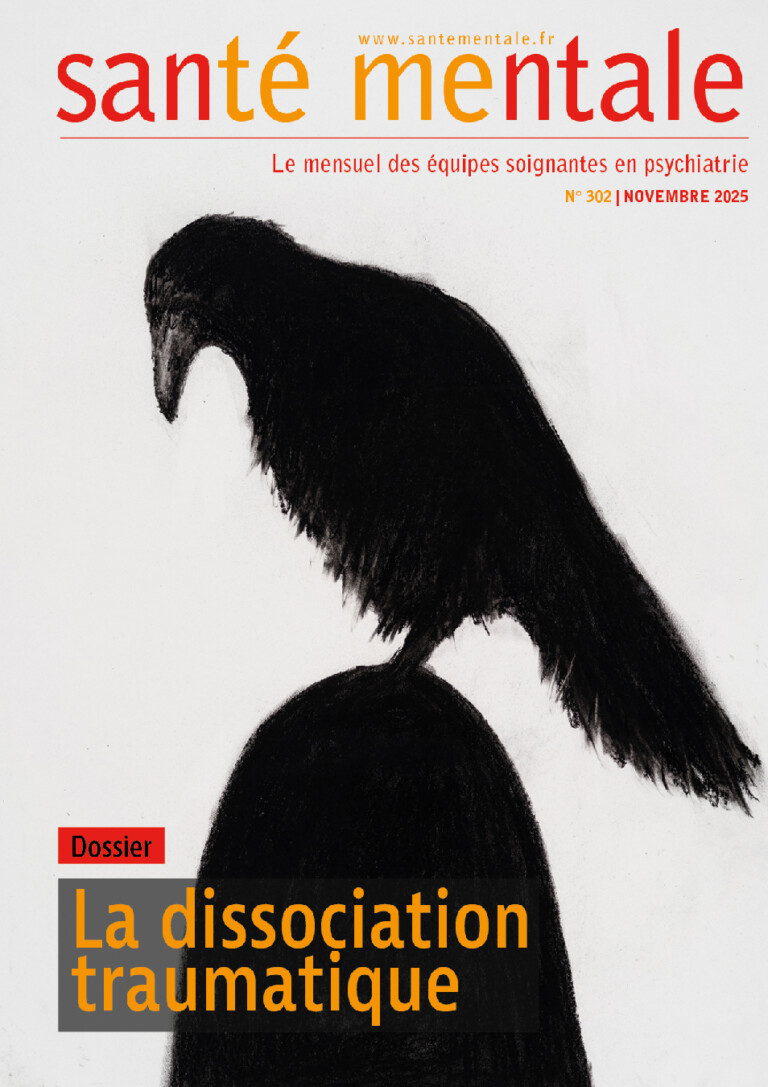Le documentaire « Loup y-es tu ? » est une plongée inédite dans le quotidien d’un Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), de son équipe soignante et de ses patients. Le film défend une certaine approche du soin, qui met en valeur les liens humains, les liens sociaux, les liens de pensées… Au cinéma partout en France dès le 13 septembre 2023. Rencontre avec Clara Bouffartigue, la réalisatrice.
Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter, souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c’est selon. Au CMPP, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, ils cheminent pour les aider à grandir. Il était une fois, derrière le symptôme, tapis dans l’ombre, des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup…
Rencontre avec Clara Bouffartigue, la réalisatrice

Comment est née l’idée du film ?
Ce film est né de ma rencontre avec l’équipe du Centre Claude Bernard qui s’est faite autour de mon précédent film, Tempête sous un crâne. J’ai
découvert avec eux un autre regard porté sur l’enfance et sur ses difficultés qui m’a bouleversée. J’ai mis cinq années à réaliser ce film. J’ai d’abord assisté aux réunions des soignants puis je suis allée dans les séances de soin des patients qui acceptaient ma présence. J’ai été frappée par la place faite aux parents, par l’approche de l’enfant dans sa globalité qui prend toujours en considération son environnement. Pour ces professionnels, il est impensable
d’accompagner un enfant sans inclure ses parents dans le processus de soin, parce que leur exclusion serait une violence subie par l’enfant, même lorsque les parents sont fragiles ou malades. Quoi qu’il en soit, ils restent les parents et il est indispensable qu’ils soient au coeur du dispositif de soin. Durant mon immersion, les vécus de toutes ces familles venaient souvent me chercher sur quelque chose de très personnel. À ce moment-là, j’ai senti que c’était un lieu extraordinaire pour faire un film de cinéma autour des liens familiaux.
Dans le film, vous ne donnez aucune indication de lieu et vous passez sous silence les raisons de la présence des familles. Pourquoi cette sorte d’anonymat ?
J’ai tout de suite souhaité me placer du côté des éprouvés, tout comme l’approche du soin dont il témoigne. Un enfant qui consulte ne comprend généralement pas pourquoi il se sent mal. Il vient pour se confier dans un cadre sécurisant. C’est un terrain de jeu et d’expérimentation en somme. Je propose aux spectateurs de vivre une expérience tangible qui s’en rapproche, en espérant qu’il en retiendra l’essentiel : l’écoute, la créativité, la patience, la bienveillance, la grande intelligence, l’absence de jugement, la permanence et les possibilités de transformation qu’elles dessinent. Mais pour cela, il était nécessaire que les spectateurs s’identifient aux uns et aux autres, à tour de rôle, enfants, ados, parents, grâce à ce chemin parcouru avec eux. Or, si on avait su dans le film les raisons pour lesquelles les patients consultent, ils
seraient immédiatement devenus «des cas spécifiques», «cet autre que je ne suis pas», et l’identification n’aurait pas opéré. Quant au fait de nommer ou non le Centre Claude Bernard, je pense que le CMPP est le lieu du film, pas
son sujet. C’est ce qui y est à l’oeuvre et qui laisse une place immense à l’imaginaire autour des liens familiaux qui est intéressant.
Comment avez-vous pu filmer chacun dans sa singularité ? Quel était le dispositif de tournage ?
Ma préoccupation centrale était : comment faire pour conjuguer le cadre du soin et le cadre du film sans que l’un ne gêne l’autre et comment faire, pour qu’au contraire, ils deviennent porteurs l’un pour l’autre. Il a fallu des mois
d’échanges avec l’équipe du centre Claude Bernard pour inventer le bon dispositif. Il ne s’agit pas comme on le croit trop souvent de faire oublier le filmeur et sa caméra, mais au contraire de lui donner une juste place et d’assumer qu’il en ait une. J’ai donc passé presque un an avec eux en séances de soin avant de commencer à filmer. C’était indispensable pour qu’ils puissent une fois la caméra introduite, relier l’oeil qui regarde à travers l’objectif à une personne devenue familière. Comment filmer l’intime sans être voyeur ? C’était le grand défi de ce film. Quand j’ai commencé à filmer les
séances de soin, j’étais en quête de leurs émotions et de la manière dont ils sauraient ou non les transformer, ni plus ni moins. Je n’avais pas besoin de filmer des psychothérapies au sens strict du terme, seulement des consultations où les choses se disent par l’intermédiaire du collectif ou du jeu.
Il n’était pas question que mon geste porte atteinte à leur intimité. Mais c’était parfois difficile à faire comprendre. Nos liens de confiance ont fait le reste.

Quel est le sens du titre, Loup y es-tu ?
Je voulais un titre qui porte l’enfance en lui et aussi la dimension de jeu. Loup y es-tu ? renvoie immédiatement à la comptine et à tous les jeux
autour du loup. Il répondait à cette exigence. Il y a aussi cette idée que, quand on vient consulter, il y a peut-être un loup… Les patients arrivent souvent en pensant qu’il y a une difficulté ponctuelle, un enfant qui a des soucis en mathématiques ou qui s’agite en classe… Ils pensent que la question qui se pose c’est ce symptôme et que, quand on y aura répondu, il
va disparaître. Mais ils découvrent vite que les choses sont plus complexes, qu’elles sont en lien avec tout un environnement dont les parents font partie. Ils vont devoir oser s’aventurer pour explorer des émotions, des vécus, des ressentis qui sont parfois très durs pour pouvoir les transformer et s’en
libérer.
Et puis oui, pour moi, le loup c’est l’inconscient et donc faut-il avoir peur du loup ?
Comment avez-vous envisagé le montage ?
Le tournage s’est étalé sur quinze mois, le montage en a pris six. J’avais établi que la narration du film se ferait en suivant une vague qui est celle que vit la plupart des patients qui poursuivent le travail au Centre. Avec le monteur, Franck Nakache, nous avons trié les séquences par émotion en leur attribuant des couleurs pour dessiner cette vague. Bien sûr, nous avons aussi tenu compte de l’alternance des personnages mais sur un mode pointilliste. Nous avons d’abord travaillé la matière documentaire en laissant la place pour des séquences d’animation.
Le montage intègre de surprenants temps de pause avec ces séquences en salle d’attente… Que cherchiez-vous à capter dans ce temps de l’attente ?
Dans les salles d’attente, on voit des choses incroyables ! C’est quand même là que tout le monde se pose. Une des choses qui m’a le plus fascinée, c’est le nombre de personnes qui s’endorment dans la salle d’attente. C’est une sorte
de sas entre la vie réelle à l’extérieur et l’espace de consultation. Il y a ici beaucoup de choses qui remontent de l’enfance que chacun garde en soi. Ce lieu, la salle d’attente, permet aussi de montrer, au-delà de ce qui se dit en
séance, tout ce qui se joue dans ce travail.
Au coeur du film, vous animez les lieux, les couloirs, la nuit, en laissant une grande place à l’imaginaire. Comment vous est venue cette idée d’insérer des séquences animées ?
L’intention des soignants est d’offrir – comme au cinéma – une sorte d’écran blanc aux patients qui leur permette de projeter leur imaginaire sur les murs. C’est une image, bien sûr. Imaginer tout ce qui a été projeté et déposé dans
ce lieu est vertigineux ! J’ai eu envie de donner vie à ces traces et comme j’aime les histoires de fantômes et de lieux hantés, j’ai imaginé ce lieu la nuit, quand tout le monde est parti. C’est ainsi que ces animations sont nées. Je souhaitais que le réel et l’imaginaire s’interpénètrent donc il ne devait pas y avoir de césure entre le matériel documentaire, dont la matière première est le réel, et la matière animée qui traitait de l’imaginaire.
Je les ai écrites à partir d’un premier montage, puis nous les avons tournées et insérées. La séquence d’ouverture avec ce petit garçon qui casse le crayon qu’il a désigné comme étant l’enfant m’a offert l’idée du personnage de ces nuits, un enfant qui porte sa blessure en lui, celle qui fait aussi sa singularité. Il chemine dans ce centre, transformant lui aussi ses désirs, à l’instar des patients qui y consultent.
Comment avez-vous réalisé ces séquences ?
J’ai pris un plaisir fou à réaliser ces animations de façon tout à fait artisanale, tout en revisitant le cinéma de genre. Ce sont vraiment des jouets que j’ai animés avec des trucages à l’ancienne, comme la surimpression. À la Méliès
en quelque sorte… J’ai choisi la magie, le merveilleux, le fantastique qui tient beaucoup à l’utilisation de la lumière. Comme je ne suis ni animatrice, ni cheffe opératrice, j’ai appelé un chef opérateur dont j’aime le travail pour avoir des
conseils. Il m’a dit une phrase qui ne m’a jamais quittée : «Éclairer, ce n’est pas rajouter de la lumière, c’est en enlever». C’était tellement en lien avec ce film, s’intéresser aux ombres pour aller vers la lumière, la révélation par la
lumière !
» Ce film est une véritable réussite. […] Authentique, vif, chaleureux, il nous conduit jusqu’aux rivages des rythmes et des couleurs originaires, exigeant de ses spectateurs la nécessité d’être là. Nous voyageons dans les salles d’attente, les bureaux des soignants, au milieu des solitudes et des colloques, des réunions de travail des psy aussi, nous sommes là, dans le partage et l’empathie. »
Roland Gori, professeur émérite de psychopathologie clinique et psychanalyste