Ce séminaire de la Chaire de Philosophie à l’hôpital propose de mobiliser les ressources historiques et conceptuelles de la philosophie pour interroger à nouveaux frais la notion de « santé mentale ». Le 16 mars prochain la pensée de Michel Foucault occupera les débats.
L’enjeu de ce séminaire coordonné par Eva Liévain, enseignante de philosophie au lycée, vise à chercher en quoi les philosophes de la tradition, bien que précédant la révolution freudienne, peuvent fournir des outils susceptibles de venir nourrir la psychiatrie contemporaine, mais aussi de sonder les raisons pour lesquelles la « santé mentale » n’avait pas chez ces penseurs la forme que nous lui connaissons. S’adressant aussi bien aux soignants qu’aux patients, aux philosophes qu’aux non philosophes, la visée de ce séminaire sera aussi de nouer un dialogue fécond avec le personnel soignant et son expérience de terrain en espérant que les ressources de la philosophie puissent contribuer à l’autoréflexion des pratiques médicales et aider à ressaisir collectivement les enjeux que ces pratiques soulèvent, tant médicalement que socialement et politiquement.
Le prochain cours aura lieu le 16 mars et portera sur Foucault et sera délivré par Philippe Fontaine, maitre de conférences en philosophie à l’université de Rouen. Les deux cours suivants seront consacrée à la psychiatrie phénoménologique (les 20 avril et 25 mai).
D'une manière générale, l'analyse des différents types de troubles de la personnalité, classiquement rangés sous la catégorie de « maladie mentale », permet de mettre en évidence l'existence d'une altération de la structure perceptive de l'espace et du temps, comme s'il s'agissait là d'un invariant psychopathologique signant sans ambiguïté l'entrée dans la psychose. On constate en effet que les altérations psychotiques de la personnalité sont toujours en rapport avec une déstructuration de la dimension temporelle du vécu et de l'être au monde, ainsi qu'une modification concomitante de la relation perceptive à l'espace, comme spatialité vécue. Cette double détérioration de ce que Kant appelait les « formes a priori de la sensibilité », conditions transcendantales de notre rapport au monde et aux autres, apparaît à l'analyse comme une expression morbide d'une désagrégation de l'image du corps. C'est l'ensemble du monde extérieur qui se trouve frappé de désorganisation dès lors que le psychotique n'habite plus son corps ; c'est le sens de la remarque de Merleau-Ponty, selon lequel « il ne faut pas dire que notre corps est dans l'espace ni d'ailleurs qu'il est dans le temps. Il habite l'espace et le temps. » C'est précisément cette manière d' « habiter » l'espace et le temps, de les « embrasser » en s'appliquant à eux, qui discrimine le normal et le pathologique. L'ampleur de cette prise mesure celle de mon existence.
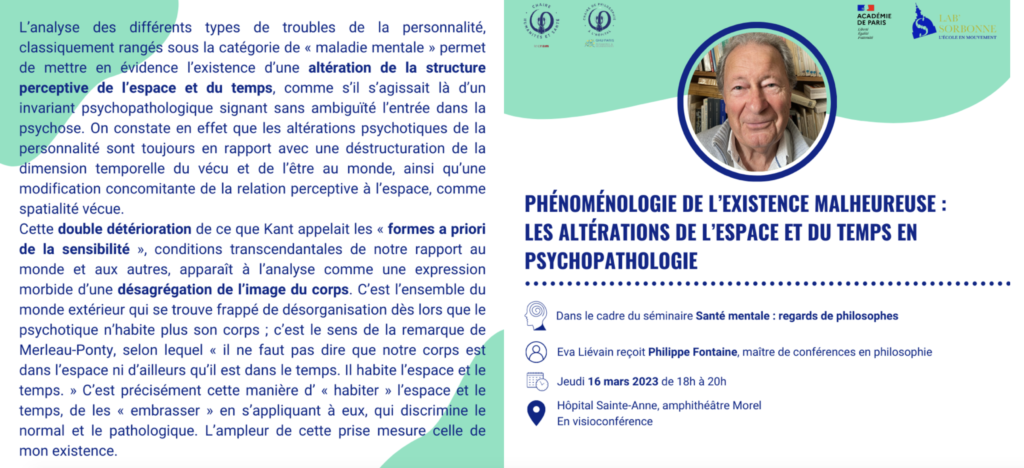
Tous les cours sont accessibles en distantiel ou se déroulent en présentiel au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, amphi Morel, de 18 h à 20 h. Chaque cours dure environ 1 h 15, et est suivi d’un temps de discussion. Les cours passés sont accessibles sur le site de la Chaire de philosophie à l’Hôpital (les Podcasts) ou en vidéo sur YouTube.
La Chaire de philosophie à l’hôpital
Depuis janvier 2016, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital se déploie, après avoir été créée à l’Hôtel-Dieu de Paris, dans différents lieux hospitaliers et de soin, et aujourd’hui au sein du GHU-Paris, Psychiatrie et Neurosciences. Cette chaire hospitalo-académique, liée à la Chaire Humanités du Conservatoire National des Arts et Métiers et dirigée par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, a pour but la diffusion des connaissances scientifiques et philosophiques à destination des étudiants, des professionnels de santé, des patients et du grand public, au travers d’activités d’enseignement, de formation, de recherche, d’expérimentation et d’organisation d’évènements. La Chaire de Philosophie à l’Hôpital fonctionne en « creative commons », en mettant à disposition ses travaux, pour mieux inventer la fonction soignante en partage et l’alliance efficiente des humanités et de la santé.
Plaquette de présentation des cours












