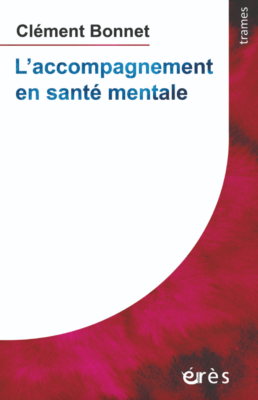Le terme d’accompagnement, largement utilisé aujourd’hui dans le champ de la santé mentale, répond à des pratiques de plus en plus reconnues. Mais il est aussi un mot-valise qui a besoin d’être explicité, estime Clément Bonnet qui signe cet ouvrage, en se donnant comme objectif de « savoir de quoi l’on parle ».
La relation d’accompagnement
Dans la première partie de cet ouvrage, l’auteur passe en revue les différentes acceptions du terme accompagnement et montre qu’il ne peut être confondu avec la notion d’aide, bien que ces deux notions soient très proches. Clément Bonnet précise que la relation d’accompagnement est « avant tout une rencontre… qui va mettre en jeu la confiance entre l’accompagnant et l’accompagné » en insistant sur le fait que dans le champ des troubles psychiques, elle demande de fortes capacités d’empathie.
L’engagement de l’auteur comme clinicien, « qui a le souci de l’autre », a fait qu’il s’est retrouvé dans ce concept d’accompagnement, ce qui l’a amené à parler d’accompagnement thérapeutique qu’il oppose à l’accompagnement social.
Certes, on retrouve l’opposition entre le cure et le care des anglo-saxons. Nous le suivrons d’ailleurs volontiers lorsqu’il dit que l’accompagnement ordinaire dans le care peut être thérapeutique et qu’il n’est pas possible de parler de cure, s’il n’y a pas également du care. Il aurait dû néanmoins ajouter que les effets thérapeutiques d’un accompagnement dans le care ne sont qu’un effet d’après-coup, lorsque l’on constate que celui-ci a entraîné une mutation significative dans le fonctionnement psychique du sujet mais, qu’en aucune manière, cet objectif ne ne peut faire partie du projet d’accompagnement, et dire que l’accompagnement équivaut à un soin est plutôt source de confusion.
Le risque de confusion
La deuxième partie de l’ouvrage, où l’auteur décline toutes les occurrences dans lesquelles il voit de l’accompagnement, illustre ce risque de confusion puisque cela va des institutions soignantes relevant de la psychiatrie médicale jusqu’au Groupe d’entraide mutuelle (GEM) où il substitue à la notion d’aide entre pairs celle d’accompagnement mutuel.
Clément Bonnet, qui a fait partie des psychiatres engagés qui ont compris très vite l’intérêt que le champ médico-social pouvait apporter aux patients, se fait l’avocat de « la nécessité d’abattre les murailles entre les secteurs sanitaire et médico-social ». Il évoque les nombreux colloques consacrés à cette question et déplore que l’on n’ait pas approfondi la pertinence des interventions différentes.
Pourtant, là où l’on s’attendait justement à cet approfondissement, les exemples cliniques qu’il nous apporte et qui sont pourtant passionnants ne nous éclairent pas vraiment, car il accole tout autant ce terme à des démarches de soins, au sens de cure ou de soins médicaux, qu’à des accompagnements en Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Si tous les soins dignes de ce nom deviennent accompagnement, quel mot va-t-il falloir inventer pour parler du travail de ceux qui cheminent auprès et avec, non plus de patients (mot qui relève de la fréquentation de soignants sanitaires), mais de personnes/usagers/citoyens en situation de handicap (psychique en l’occurrence) en leur apportant un étayage de réalité et de projet d’une plus grande autonomie, comme on le voit dans les Services d’accompagnement médico-sociale pour adultes handicapés (Samsah) ou les SAVS ?
C’est la double approche des soins et de l’accompagnement (social) qui ne se succèdent pas nécessairement mais sont souvent simultanés, qui permet au sujet de ne pas être pris dans la totalisation de n’être qu’un patient toutes les heures de sa vie, quelle que soit la qualité des soins qui lui sont prodigués, comme on l’a vu souvent avec ce que l’on a décrit comme le « tout secteur ».
Malgré la richesse des exemples cliniques apportés, nous restons quelque peu frustrés que ce repérage n’ait pas été poussé plus avant, en sachant qu’il implique également de mieux définir la nature du soin psychiatrique proprement dit. Cela est d’autant plus nécessaire que l’auteur évoque avec lucidité les risques qui existent aujourd’hui de demander aux structures à vocation d’accompagnement de pallier les insuffisances de moyens des secteurs psychiatriques. Par exemple, des Samsah ou des Service d’éducation spéciale et soins à domicile (Sessad) peuvent avoir aujourd’hui le sentiment d’assurer des soins à moindre coût.
Les agences territoriales de santé mentale
Dans la troisième partie de cet ouvrage, Clément Bonnet esquisse quelques propositions visant à ce que le dispositif de soins sanitaire, le médico-social et le social soient plus fluides et mieux intégrés sur le plan territorial ; il suggère ainsi la création d’agences territoriales de santé mentale.
Malgré ces réserves, cet ouvrage mérite d’être lu, car il nous montre la richesse que constitue la mobilisation collective pour permettre aux personnes en souffrance psychique de bénéficier de soins en même temps qu’un accompagnement qui « implique la reconnaissance de l’autonomie du sujet dans un processus d’émancipation… afin de leur permettre de vivre comme tout le monde ».
Une lecture critique de Bernard Durand, octobre 2021
L’accompagnement en santé mentale, Clément Bonnet, Éd. érès, avril 2021, 18 €.