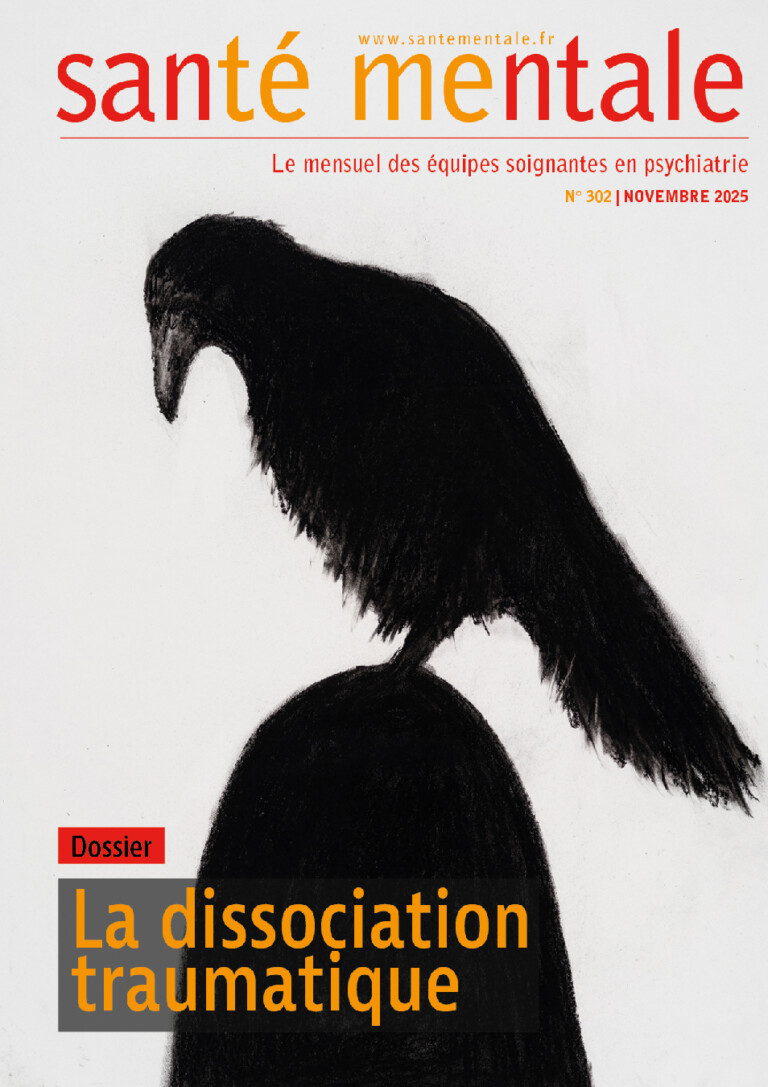La formation des infirmières en pratique avancée m’a remis en mémoire le temps où j’allais à Créteil, à la fac. A Paris XII. J’aimerais que mes jeunes collègues éprouvent la même joie ; qu’eux aussi s’émerveillent de ce temps où il est permis, à distance du terrain, d’élaborer une pensée du soin.
Intégrer l’alma mater ne fut pas simple. En dehors de mes propres représentations ouvrières qui m’incitaient à fuir un lieu identifié comme celui de l’intelligentsia, forcément détachée d’un terrain quasiment mythifié, l’administration de l’établissement où je travaillais ne me facilita pas la tâche. L’université ce n’était pas pour les « simples » infirmières. Il fallait au moins être surveillant ou surveillant-chef pour y prétendre. La formation continue refusa de me prendre en charge. Je dus donc finacer ma formation et dégager cinquante-cinq jours annuels de formation d’un temps-plein. Tous mes congés et jours fériés y passèrent et il en manquait encore. Quelques jours sans solde y pourvurent.
Motivé
Dans ces conditions, la rédaction des trois pages de lettre de motivation, fut une formalité même si chaque mot y était pesé. Ma motivation était évidente. En béton armé même. S’arrêter pour réfléchir à un parcours professionnel de plus de dix ans n’était pas du luxe. Comment trouver le fil qui reliait mes différents rencontres avec les patients, mes collègues, les activités proposées, les lieux où j’avais exercés sans oublier les méandres d’une vie personnelle mouvementée ? Comment l’université s’inscrivait-elle dans ce parcours ? J’avais pris la question par l’autre bout, et pourquoi pas ? « Abandonner ainsi la blouse blanche, symbole de cette profession piège, seconde peau que l’on endosse tous les jours jusqu’à la retraite ? Devenir, moi aussi, détenteur d’un Savoir ! Avoir la maîtrise sur ces événements qu’on subit, sur ces symptômes que l’on se prend dans les gencives, faute de pouvoir leur trouver un sens. Devenir, moi aussi, un Maitre des mots … dont la Parole soignerait ces patients qui de répétitions en rechutes n’en finissent pas de nous mettre en échec … » Je me souviens que j’avais conclu ce premier paragraphe par un retentissant « Foutaises ! » Je n’avais encore publié qu’un texte et je maniais déjà le « Foutaises ! » comme un maître. L’université ce n’était pas par défaut, j’adorais ma profession et je ne me sentais pas piégé par une blouse que je ne portais de toute façon pas. Il ne me restait plus qu’à déplier ma manière d’être infirmier. Depuis je n’ai pas cessé.
Ma candidature fut donc retenue. A la fin des années quatre-vingt, les facs de médecine se vidaient. La forte baisse du numerus clausus avait ouvert la porte à des deuxièmes cycles destinés aux infirmières. Jean-Yves Audigou et Dominique Letourneau, les responsables de la formation, avaient su saisir l’opportunité et construit le projet d’une maîtrise en Sciences et Techniques, option santé mentale. Le ministère de la santé ne l’ayant pas reconnue, elle avait été ironiquement rebaptisée « Option Hygiène mentale ». Je considère depuis, que l’université c’est l’hygiène mentale des infirmières indépendamment de toute volonté de reconnaissance professionnelle.
Nous nous retrouvâmes à seize. Des hommes et de femmes aux parcours diversifiés qui venaient de la moitié Nord de la France. Une majorité d’entre nous habitaient en région parisienne.
Une idée du soin comme discipline
Les premiers six mois de cours furent assez classiques. Ils visaient à nous permettre de valider un niveau DEUG (Diplôme Universitaire d’Etudes Générales) qui nous donnerait ensuite accès à la maitrise proprement dite. Nous revisitâmes la psychopathologie, les neurosciences et la psychanalyse, les politiques sanitaires et sociales, la pharmacologie, les sciences humaines et sociales, etc. toutes les matières de base nécessaires à un exercice infirmier éclairé. Je m’étais, globalement, beaucoup ennuyé pendant ma formation initiale. Ces connaissances à recracher, ces conduites à tenir coûte que coûte, sans avoir à y penser, tout cela, bien que parfois nécessaire, ne mobilisait qu’une partie de mon cerveau. Les enseignants, à la fac, ne cherchaient pas à nous remplir la tête de connaissances parfois fastidieuses mais visaient à nous faire réfléchir, qu’il s’agisse de la façon dont fonctionne un traitement retard ou de la logique à l’œuvre dans la loi du 30 juin 1838. Et ça changeait tout. Ils ne cherchaient pas à produire des infirmières obéissantes mais des professionnelles douées de raison et d’intuition, tant l’une et l’autre se nourrissent. Evidemment cette approche ne convenait pas à tous les soignants. Cinq d’entre nous ne réussirent pas à valider ce Deug.
Jean-Yves et Dominique, tous deux infirmiers, avaient eux-mêmes suivi un parcours universitaire. Ils avaient une idée de la discipline. Le découpage des enseignements et l’esprit dans lequel ils étaient délivrés suivaient cette conception du soin. Les infirmières œuvrant en psychiatrie n’étaient pas des auxiliaires médicales mais des professionnelles dotées d’un rôle propre qui justifiait la prise d’initiatives pensées dans un champ spécifique, indépendant de la pensée médicale. Un ouvrage publié aux Editions Lamarre en retraçait les contours. (1)
Les disciplines ne s’emboitaient pas
Des enseignants de qualité issus de nombreux champs des sciences humaines nous proposèrent un voyage très riche. Je ne les citerai pas tous de peur d’en oublier. Certains noms sont aussi tombés dans un relatif oubli. La plupart n’évoqueront rien à des professionnels qui lisent peu. L’essentiel est l’étincelle qu’ils ont produit et comment nous nous sommes parfois enflammés. Bien sûr, certains d’entre nous râlaient, habitués à un enseignement plus scolaire. Les disciplines ne s’emboitaient pas. Les affirmations des sociologues étaient démenties par celles des psychanalystes ou des philosophes. La clinique (celle que nous connaissions) ne recoupait pas tout à fait les questions posées par les phénoménologues. Nous devions naviguer entre ces différents savoirs disciplinaires pour construire le nôtre. C’était épuisant intellectuellement mais passionnant. On ne nous demandait pas de savoir mais de critiquer. Nous ne validâmes pas nos unités de valeurs en présentant la loi de 1901 sur les associations mais en examinant comment il était possible de s’en servir pour faciliter la participation des patients à l’organisation des soins et quels en étaient les écueils. Il ne fut pas simplement question de présenter l’Instruction sur la manière de gouverner les Insensés de 1785 mais de repérer pourquoi elle était restée lettre morte et ce que la loi de 1838 lui devait. Au niveau clinique, il ne s’agissait pas simplement de décrire sémiologiquement les voix mais de réfléchir sur le statut de la perception et ce que modifie pour un sujet de ne plus pouvoir faire confiance à ses perceptions. Nous étions invités à penser les soins dans un registre disciplinaire, notamment au niveau de ce qu’ils produisent dans un triple registre : relationnel, technique et éducatif, le tout en lien avec les différents champs des sciences humaines : anthropologie, sociologie, philosophie, etc.
Et le quotidien alors ?
Quant à imaginer comment nous pourrions irriguer notre exercice quotidien à partir de ces lectures, questionnements, critiques, nous avions le projet de mémoire pour y répondre provisoirement. En ce qui me concerne, j’avais choisi de travailler autour d’une médiation : la lecture. Je m’y demandais ce qui m’autorisait à penser que cette activité était psychothérapeutique. Je ne savais pas alors que j’aurais à repenser entièrement le fonctionnement de l’hôpital de jour où je travaillais.
Sur un plan pratique, les apports de la maîtrise, au niveau des bénéfices institutionnels, furent tels que mes deuxième et troisième années furent pris en charge à cinquante pour cent. Les collègues qui me succédèrent dans cette démarche purent être entièrement financés par la formation continue.
Quel infirmier serais-je devenu si je n’avais fréquenté les bancs de l’université, si je n’avais croisé ces étudiants de médecine tout à fait indifférents à notre présence dans leur lieu, si je n’avais rédigé ce mémoire de maîtrise qui m’emmena au bout de ce que je pouvais me représenter du soin ? Mon exercice et ma réflexion en ont été enrichis. J’ai traversé les années qui ont suivi avec la sensation d’une maturité professionnelle dont je n’avais pas conscience auparavant. Basique ou avancée, assumée ou éclairée, ma pratique en a été modifiée, conscientisée. Elle a nourri mes écrits et mes réflexions.
L’université n’est pas conçue pour fabriquer de super-techniciens. Elle est un exercice d’ouverture. Ouverture à l’autre, ouverture à ce qui vient, ouverture aux possibles. A partir d’un sens critique affuté qui permet de ne pas lâcher la proie pour l’ombre. Elle permet de différencier pratique et praxis. Au faire instrumental, qui se décline en protocoles et conduites à tenir, elle oppose l’action qui transforme le sujet, la pratique qui se théorise et vise à l’exercice d’une activité autonome. Autonome et responsable, il n’est pas de plus beaux attributs pour un infirmier psy.
Dominique Friard
1– Letourneau (D), Dupeux (D) (dir.), Le secteur psychiatrique, Les Guides de l’infirmière magazine, Editions Lamarre, Paris, 1991.