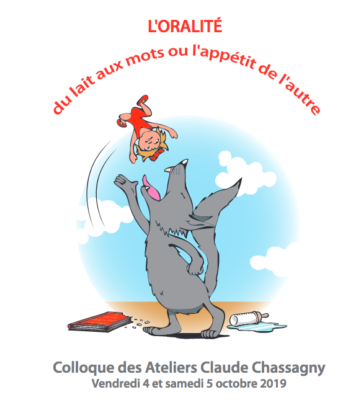PARIS
Colloque annuel des ateliers Claude Chassagny
« Il n’a que ce mot à la bouche », « Je lui ai mis l’eau à la bouche », « On m’a enlevé le pain de la bouche », « C’est une fine bouche ! », « Encore une bouche à nourrir, une bouche inutile », « Motus et bouche cousue », « Elle passe son temps à dévorer des livres », etc.
On perçoit dans ces expressions populaires, au propre comme au figuré, le lien entre l’alimentation et la parole, la question de la limite entre le dedans et le dehors, ce que l’on prend et ce que l’on rejette. La nourriture répond au rêve de notre âme comme à l’appétit de nos entrailles. Elle présente à la fois une dimension métabolique, symbolique (elle engage notre imaginaire et notre affectivité) et culturelle (elle touche donc notre identité).
Mais la bouche ne sert pas qu’à se nourrir. L’oralité est fondatrice de l’être. Elle est présente dès la vie fœtale : au cours du troisième mois de grossesse, le fœtus suce son pouce, crache, souffle, inspire. Puis, à la naissance, la bouche, par le cri, est le premier lieu d’expression de soi, ainsi que le premier lieu du plaisir et de la survie, par la tétée. Comment cela est-il vécu par des bébés prématurés, hospitalisés, séparés de leur mère ?
Ainsi, comme le montre la psychanalyse, au cours de la construction de l’être humain, l’oralité alimentaire et l’oralité verbale sont intimement liées. La bouche et son fonctionnement se trouvent ainsi impliqués dans toute une série de fonctions centrales dans l’ontogenèse de la personne (attachement, étayage des pulsions, sevrage, instauration du langage). Le rapport au monde du sujet en devenir est dominé par l’incorporation où se jouent les premiers enjeux identificatoires. La vie de relation vient se fonder, s’appuyer sur l’autoconservation. C’est par la bouche que l’enfant délimitera progressivement le registre du besoin et celui du désir. Selon le principe de la négation établi par Freud, le fait d’avaler ou de rejeter participe fondamentalement à la délimitation du monde interne et externe.
Les premières productions sonores sont de véritables substances matérielles remplissant la bouche. La corporéité des mots est au plus près de la sensorialité. L’enfant explore sa bouche par des jeux phonématiques et corporels, dans une activité auto-érotique, source originelle de l’accès au symbolique et au langage.
On retrouve cette même plénitude de plaisir dans l’expérience de la narration et de l’entrée dans l’imaginaire : jeux de doigts, comptines, vire langues, histoires, contes, jeux de faire semblant. Que dire alors des enfants intubés, gavés, aspirés, pour raisons médicales et qui développent par la suite des troubles anorexiques, des troubles du langage ou de la voix ? De la bouche vide ou trop pleine des enfants mutiques, des enfants autistes dont le démantèlement sensoriel empêche tout écart avec l’objet en présence, toute rêverie ou travail de représentation ? Que dire des personnes âgées dépendantes à qui il ne reste parfois que les cris ou le refus de s’alimenter pour se dire, s’affirmer, rester sujet ? Et d’autres qui ont subi une chirurgie bucco-pharyngée et dont la parole comme l’alimentation sont frappées de plein fouet ?
Dans les civilisations de tradition orale, c’est par la parole que tout est transmis, mémorisé, transformé de générations en générations. Les contes ont alors un rôle très important de transmission des valeurs, des interdits, de partage des émotions vécues. Ils sont l’occasion d’une prise de parole singulière au sein du collectif. Ils sont à l’origine du lien social.
Qu’est donc devenue la fonction de narration, subjective et singulière par essence ? Quelle place reste-t-il pour se dire, pour se raconter dans nos sociétés modernes où la technicité croissante du langage fait rage, où l’on recherche constamment l’objectivité, la standardisation ? Que deviendra l’humain sans la parole ?
Rens. : tél. : 06 26 82 46 43, atelierchassagny@gmail.com, www.acchassagny.org