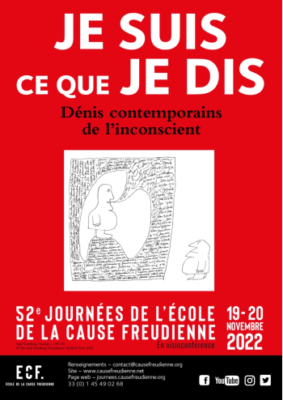L’École de la cause freudienne (ECF) organise ses 52es journées d’étude les 19 et 20 novembre 2022 sur le thème « Je suis ce que je dis. Dénis contemporains de l’inconscient » en visioconférence.
Pour ses 52es journées d’étude, l’ECF propose d’explorer le thème de l’identité, à partir d’une mutation contemporaine du cogito cartésien que J.A Miller formule ainsi : « Je suis ce que je dis ».
Les exposés cliniques et théoriques du samedi dans des salles multiples, et la plénière du dimanche, centrée sur les questions éthiques, épistémiques et politiques, visent à orienter le travail avec les sujets rencontrés. Ces Journées s’adressent aux psychanalystes, psychologues, psychiatres, aux praticiens de la santé mentale et du champ médico-social, et à tous ceux confrontés aux abords des questions que soulève le thème.
Le « Je suis ce que je dis » à l’épreuve de la pratique en internat
Gaëlle Terrien, de l’équipe diffusion des J52, a interviewé Ophélie et Gaël, deux éducateurs d’un internat médico-social.
G. T. — Me diriez-vous un mot sur ce que vous inspire le titre des prochaines Journées de l’École de la Cause freudienne ?
G. — « Je suis ce que je dis ». Ce n’est pas facile de dire qu’on est ceci ou cela. C’est peutêtre une défense. C’est éluder la question du ratage pour chacun.
O. — Dans notre travail, on peut aussi se dire « je suis manquant », savoir ne pas savoir — c’est ce qui arrive le plus souvent, en fait.
G. T. — Qu’est ce qui fait institution selon vous ? Pour le praticien, et pour les jeunes accueillis ?
G. — L’institution est une toile de fond dans laquelle se rejouent des scènes pour le sujet, du quotidien, de la famille. Nous ne pouvons pas être extérieurs à cette scène, cela nécessite de l’engagement pour y introduire du nouveau.
O. — Tel enfant disait : « on dirait que je suis policier et toi tu es le voleur ». Si nous ne rentrons pas dans cette scène, il ne peut traiter sa question. Il faut se laisser diriger, de façon avertie, pour savoir ce qui s’y joue. Notre orientation, le travail en équipe nous permettent de nous questionner sur notre pratique et l’institution vient fixer un cadre à nos interventions en laissant le champ libre à nos inventions.
G. T. — Quelle place est accordée à la parole et le sujet dans votre institution et dans votre pratique ?
G. — La parole est notre outil de travail, avec tout ce qu’elle a d’équivoque. C’est aussi ce qui vient séparer quelque chose dans la relation à l’autre.
O. — La parole nous distingue du monde animal. On répète aux enfants de mettre des mots sur ce qui les traverse plutôt qu’être dans l’agir. Une enfant, par exemple, a trouvé sa solution en venant nous dire quand elle avait envie de faire une bêtise, plutôt que de la faire.
G. — La parole humanise les pulsions. Faire des demandes, c’est être dans la relation à l’autre, là où parfois certains ont l’air débranchés de cet autre.
G. T. — Comment faites-vous avec cette parole que vous accueillez ? Rencontrez-vous cette question du « je suis ce que je dis », qui parfois fige l’être ?
G. — On essaie d’accueillir la parole comme elle se présente, de ne pas en avoir peur. On cherche ce qu’elle veut dire. Parfois on essaie de la voiler, de la couper, de la ponctuer, de la border.
O. — Le « je suis ce que je dis »me fait écho à cet enfant présenté par les parents comme celui qui parle trop. Il a repris cette assignation, se présentant comme « celui qui doit fermer sa gueule ».
G. — Mais dès le début, il a aussi pu dire « je suis inventeur d’inventions ». La construction d’objets est venue border cette parole incessante afin qu’il puisse dire.
G. T. — Dans un document déjà paru, préparatoire aux Journées de l’ECF(1 ) il est question de l’institution comme lieu d’accueil du symptôme, lieu refuge, et base d’opération. Est-ce que cela vous fait écho ? Comment en faites-vous l’expérience ?
O. — Le symptôme est l’expression d’une souffrance. Le but n’est pas de le faire taire mais que l’enfant trouve sa solution pour qu’il soit plus acceptable socialement. Nous ne rééduquons pas les enfants.
G. — Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe, mais si nous refusons de l’accueillir, nous courons le risque de l’empêcher de s’exprimer. Les symptômes ont une fonction et nous devons nous interroger sur ce que cela vient dire pour chaque sujet.
O. — Les trouvailles viennent de l’enfant. Une enfant est passée par l’écriture pour traiter une part de son histoire, mais les mots étaient très crus. Nous l’avons accompagnée dans cette écriture, et elle est parvenue à voiler les mots et les images qui la traversaient. Son écrit a progressivement pris la forme d’un récit.
G. — À la fin de son accueil, elle m’a demandé de lire et d’écrire quelques mots avec elle. Elle s’est appuyée sur chacun de nous, elle a introduit de l’autre. Son livre a été imprimé et relié au moment de son départ du service.
G. T. — Merci Ophélie et Gaël pour cet échange très intéressant. Rendez-vous aux Journées 52 !
1. Cf. Guilaumé G., Guivarch A., Le Bouëtté A., Michel-Spiesser M., Terrien G., « L’institution, un lieu, un lien », document de la Commission diffusion des J52.
Rens. : 01 45 49 02 68, contact@causefreudienne.org
Inscription : https://events.causefreudienne.org/journees-ecf/131-je-suis-ce-que-je-dis-denis-contemporains-de-l-inconscient.html