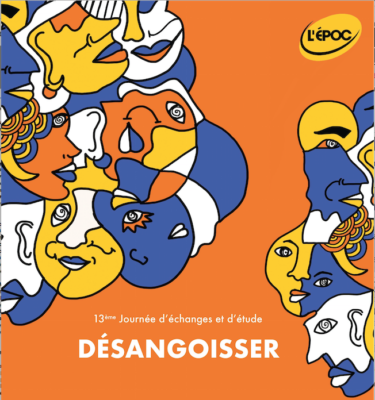PARIS
13e Journée d'échanges et d'étude de l'Espace psychanalytique d'orientation et de consultations (Epoc)
L’angoisse réveille, inonde le quotidien et peine à s’évaporer. D’aucuns cherchent à la mettre à distance, à la combattre en la réduisant à un « stress » que l’industrie pharmaceutique s’emploie à amenuiser toujours davantage. Ainsi les français sont de grands consommateurs d’anxiolytiques.
L’angoisse s’invite là où on ne l’attend pas et elle reste un affect à la charge des sujets. On la baptise parfois « angoisse sociale », on a affaire à des « phobies sociales », on redoute le « stress » et les « risques psycho-sociaux » qui sont autant de formes d’angoisse survenant par crises ou infiltrant durablement le vécu. L’angoisse ne dépend pas d’un objet extérieur précis comme la peur ; elle n’est pas non plus déclenchée par un événement qui surprend brutalement comme dans l’effroi. L’angoisse expose le sujet à un danger imminent mais indistinct. On la rencontre dans toutes les structures cliniques et chacun la traitera de façon singulière.
Désangoisser ? Oui, mais cela suppose de repérer à quoi tiennent les angoisses en jeu. À quelles situations sociales, à quelles dispositions subjectives, à quelles relations primordiales sont-elles liées ? L’étudiant crispé sur sa feuille blanche, le travailleur soucieux de la précarité de son emploi, l’amoureuse inquiète des tromperies de son partenaire, le malade qui voit son état s’aggraver, la personne âgée face à sa perte d’autonomie, le rêveur surpris par un cauchemar, le professionnel face à une situation complexe, chacun peut ressentir cette angoisse immaîtrisable, perturbante. Mais l’angoisse n’est pas que trouble. Elle peut avoir d’autres fonctions, par exemple d’être un signal salvateur qui renseigne le sujet sur un problème inaperçu. Elle peut aussi ouvrir le sujet à une nouvelle perspective de désirer jusqu’ici masquée ; elle peut appeler à symboliser un manque dans l’Autre qui ménage une nouvelle place à occuper. Loin de se réduire à une déstabilisation, l’angoisse concerne donc le sujet affecté par le désir de l’Autre. Elle n’est pas sans objet. Alors à quelle place situer le besoin de désangoisser ?
Prenons la distinction entre « angoisse constituée » et « angoisse constituante ». La première c’est l’angoisse décrite dans tous les ouvrages de psychopathologie, l’angoisse qui inhibe, qui retient de passer à l’acte, qui fait perdre ses moyens. Il convient donc de s’en dégager, de s’en passer, de contrer ses effets.
L’angoisse constituante au contraire peut servir les intérêts du sujet, c’est celle sur laquelle il peut prendre appui pour en faire la cause de son désir pour écarter les forces qui l’accablent d’exigences, de pressions voire de menaces sourdes. Au contraire, l’angoisse constituante pousse le sujet à des transformations de sa situation et de sa relation avec l’Autre. Cette angoisse constituante, on peut donc s’en servir, il n’est pas question avec elle de « désangoisser », car elle n’a pas l’influence délétère de l’angoisse constituée.
Mieux vaut sans doute aider l’angoissé à trouver la logique subjective qui sous-tend son angoisse constituée et suscite le symptôme. On peut aussi encourager le sujet à poser un acte réfléchi qui libère la certitude attenante à l’angoisse.
Pour autant « désangoisser » ne peut viser à une normalisation mortifiante au seul bénéfice d’une adaptation sociale qui aligne tout le monde sur le même modèle. À l’inverse désangoisser sera confirmer le sujet dans sa singularité, le réconcilier avec lui-même pour qu’un reste d’angoisse soit l’aiguillon de sa progression et de son élaboration.
Rens. : tél. : 06 84 23 52 89, contact@lepoc.org, www.lepoc.org