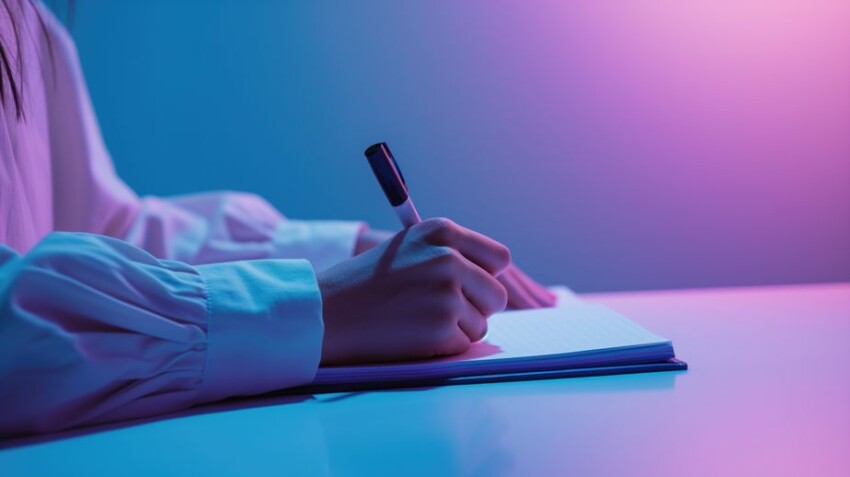L’Association pour le Développement de la Recherche en Soins en Psychiatrie (ADRpsy) propose à ses adhérents un format de publication original sous la forme d’ « éditos de la recherche en soins psychiatriques ». Il s’agit de nourrir la dimension intellectuelle et militante de l’association et de valoriser la recherche en soins psychiatriques sous des formes lisibles et incarnées, accessibles à tous. Benjamin Villeneuve, Président de l’ADRpsy, nous livre un premier « édito » intitulé « De l’ANFIP à l’ADRpsy : la filiation associative d’un soin qui résiste. L’héritage en mouvement« .
Dans un contexte où la communication associative se fragilise et où les espaces de parole se raréfient, l’ADRpsy souhaite créer un format éditorial vivant et engagé, permettant à ses membres de prendre la parole sur les enjeux du soin psychiatrique, de la recherche et du collectif. Ces éditos se veulent à la fois inspirants, accessibles et porteurs de sens. Ils incarnent une continuité : celle d’un mouvement qui pense le soin, agit pour la recherche, et défend la parole des professionnel·les comme des personnes concernées. Il s’agit de créer, au sein de l’ADRpsy, une culture éditoriale collective, où les voix des chercheur·es, praticien·nes, personnes concernées et formateur·rices se croisent et se répondent.
De l’ANFIP à l’ADRpsy : la filiation associative d’un soin qui résiste.
L’héritage en mouvementproposé
par Benjamin Villeneuve, président de l’ADRpsy
Il existe des filiations qui ne se fanent pas. Elles se transmettent, se recomposent, et refont surface lorsque le présent vacille. L’histoire de l’ANFIP (Association nationale fédérale des infirmiers en psychiatrie) appartient à cette lignée. Elle naît le 14 mai 1982, au Centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, dans le sillage d’expériences locales foisonnantes, inventives, parfois désordonnées mais profondément vivantes. Là, un petit groupe d’infirmier·ères psychiatriques prend conscience de la nécessité de s’unir pour faire reconnaître la valeur de son travail, face au stigmate persistant qui pèse sur la psychiatrie et à la condescendance souvent exprimée par les confrères des autres disciplines. De cette tension naît une idée simple et puissante : se constituer en collectif capable de défendre une identité professionnelle singulière et d’affirmer la légitimité du soin psychiatrique au sein du champ infirmier.
Naissance et montée en puissance : du noyau militant à la fédération
Tout commence modestement, presque à mains nues. Le geste fondateur a quelque chose d’artisanal, de fragile, mais d’inflexible. On se réunit après les gardes, on griffonne des tracts, on se dispute sur les mots, mais on avance. Chacun·e met la main à la poche : l’argent personnel sert à acheter un répondeur à bandes magnétiques — capricieux, bruyant, mais symbole d’un lien qui se tisse. On relance, on ajuste, on apprend à faire avec les moyens du bord. À force de ténacité, les premières annonces paraissent dans la presse locale, puis, quelques mois plus tard, dans Le Monde et Libération. Le ton change : la parole psychiatrique sort de l’ombre. Les adhésions affluent, les courriers s’empilent, les rencontres s’enchaînent. Ce qui n’était qu’un noyau militant devient une force en mouvement. Peu à peu, un maillage national se dessine : des hôpitaux, des équipes, des visages se répondent. L’ANFIP se reconnaît, se nomme, s’agrandit. En 1987, elle se fédère — la flamme locale devient fédération nationale. La formation devient alors son levier le plus politique. Un département dédié se met en place : des stages se conçoivent, s’expérimentent, s’affinent, portés par une même conviction — que la compétence psychiatrique ne relève ni du hasard, ni du charisme, mais d’un savoir, d’une pratique, d’une identité à part entière. Mais ces formations ne se contentent pas de transmettre : elles ouvrent des espaces de réflexion inédits sur l’engagement professionnel, sur la posture, sur le travail sur soi. On y parle de la place du sujet, de la distance, du transfert, de l’équipe, du sens. Ce sont des lieux où se fabrique autant une profession qu’une conscience collective. Quand le siège est déplacé à Paris, le geste n’est pas anodin : c’est une manière d’assumer la dimension politique du projet, de prendre place à la table où se joue l’avenir du diplôme et, plus largement, celui du soin psychiatrique. Pour la première fois, les pouvoirs publics identifient les infirmiers psychiatriques non plus comme des exécutants, mais comme des interlocuteurs légitimes, capables de penser, de former et d’agir sur leurs
propres conditions d’exercice.
1988 : être dans le mouvement, faire exister la psychiatrie
La fin des années 1980 ouvre une brèche. À l’automne 1988, la rue gronde : des centaines de milliers d’infirmiers se mobilisent, font corps, se découvrent une puissance collective. L’ANFIP n’observe pas — elle agit. À Clermont-Ferrand, on affrète des wagons entiers pour rejoindre la capitale. Dans les couloirs de Sainte-Marie, les listes s’improvisent, les tracts circulent, les équipes s’organisent. La psychiatrie veut être là, visible, debout, au milieu du mouvement. Et c’est là tout le paradoxe — et toute la force — de ces infirmiers psychiatriques longtemps cantonnés au rôle du « gardien de l’ordre asilaire ». Ils et elles s’en saisissent avec intelligence. En assurant le service d’ordre des manifestations, ils retournent cette image : le corps collectif devient outil politique. On montre la maîtrise, la cohésion, ladiscipline choisie. On prouve que l’on peut tenir la ligne autrement — sans renier l’histoire, mais en la transformant en levier d’action. Ce geste symbolique vaut manifeste : la psychiatrie ne se cache plus, elle occupe l’espace public. Cette visibilité nouvelle ouvre des portes. Dans les négociations, les voix psychiatriques ne sont plus reléguées au fond de la salle. Elles prennent place, posent des mots, défendent un projet. On comprend enfin qu’elles ne sont pas que des bras, mais des têtes pensantes, capables de débattre, de construire, de proposer. Pour un temps, la psychiatrie se défait de son stigmate institutionnel : elle devient utile, fiable, nécessaire au collectif infirmier.
Lire l’intégralité de l’article (PDF)
L’ADRpsy (Association pour le Développement de la Recherche en soins en psychiatrie), créée en 2022, se propose de rassembler des infirmiers et soignants se distinguant par leur curiosité, leur rigueur, et qui œuvrent à leurs travaux ou projets de recherche dans un contexte souvent peu propice. Des infirmiers et soignants qui cherchent, se mettent en recherche, puis font de la recherche. L’ADRpsy reste sensible aux approches et voies d’accès à la connaissance qui relèvent de sciences, d’épistémologie, et de méthodologies différentes. La volonté reste avant tout d’interroger rigoureusement les soins au bénéfice des patients. Si la création de l’ADRpsy est initiée par des infirmiers , la recherche en soins est un domaine partagé par les autres métiers de la santé. A cette fin, l’ADRpsy est ouverte à tous les professionnels du champ de la psychiatrie, et une commission interne infirmière est chargée de répondre spécifiquement aux questions et enjeux autour de cette profession. • Devenir membre de l'ADRpsy