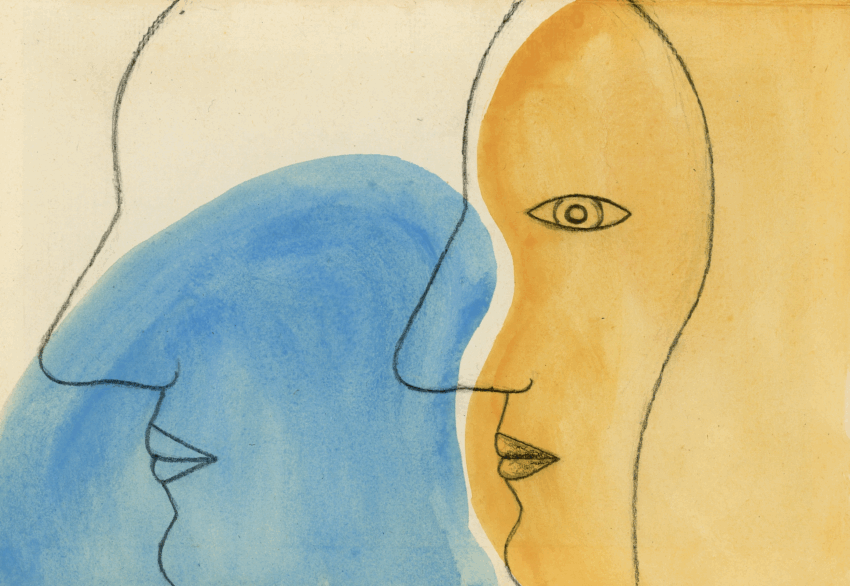Un projet doctoral mené par Vincent Billé, candidat au doctorat en sciences infirmières à l’Université de Montréal, vise à explorer la coercition informelle (CI) en milieu psychiatrique afin d’en comprendre les caractéristiques, les dynamiques à l’œuvre et les stratégies de résistance possibles.
Le recours à la coercition est fréquent en psychiatrie, allant des mesures formelles (isolement, contention) à des formes plus discrètes de pression, dites informelles [1]. La coercition informelle (CI) désigne ainsi toute influence indirecte exercée pour orienter les choix d’une personne dans le cadre de ses soins, par exemple via la persuasion ou la menace. Bien que sa prévalence soit estimée entre 29 et 59 % [2], la CI reste souvent sous-estimée et normalisée dans les pratiques, au nom de l’adhésion au traitement ou de la conformité aux normes sociales [3]. Ces pratiques peuvent toutefois engendrer des effets délétères : sentiment de déshumanisation, altération de la relation thérapeutique et tensions éthiques pour les intervenant·es [4]. Une meilleure compréhension des dynamiques institutionnelles, culturelles et relationnelles qui sous-tendent ces pratiques apparaît essentielle.
Ce projet doctoral intitulé « Pratiques de la coercition informelle en psychiatrie : une ethnographie critique« vise ainsi à explorer la CI en milieu psychiatrique afin d’en comprendre les caractéristiques, les dynamiques à l’œuvre et les stratégies de résistance possibles. Cette recherche qualitative, menée au Québec, s’appuie sur une ethnographie critique [5] et la perspective des mad studies [6], afin de porter une attention particulière aux savoirs expérientiels, au sanisme (psychophobie) et à l’injustice épistémique vécue par les personnes hospitalisées.
La collecte de données est en cours dans deux unités psychiatriques montréalaises, et inclut entre autres observations, conversations informelles, entrevues semi-dirigées (auprès des personnes hospitalisées, de leurs proches et des intervenant·es), et analyse de documents institutionnels. Un comité consultatif composé de personnes premières concernées participe à chaque étape, renforçant son caractère inclusif et partenarial. Pour garantir son intégrité et sa qualité, cette recherche s’appuie sur ces stratégies de scientificité : pertinence, rigueur, sincérité, crédibilité, transférabilité, contribution, éthique et cohérence [7].
Les retombées attendues incluent une meilleure compréhension des enjeux liés à la CI, le développement de pratiques d’intervention non oppressives et la reconnaissance des savoirs expérientiels. Un plan de mobilisation des connaissances est prévu à destination des milieux cliniques, associatifs, politiques et du grand public, incluant notamment la création d’une œuvre de danse contemporaine inspirée les résultats de cette recherche.
Dirigé par Pre. Marie-Hélène Goulet à la faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, codirigé par Pr. Pierre Pariseau-Legault au département des sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais, et en partenariat avec Julie Tansey facilitatrice de rétablissement, ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique de recherche collaborative en psychiatrie au Québec.
Vincent Billé est actuellement candidat au doctorat en sciences infirmières à l’Université de Montréal. Après avoir complété les cours (philosophie des sciences infirmières ; synthèse des connaissances pour les sciences infirmières ; méthodes de recherche en sciences infirmières ; formation et leadership en sciences infirmières ; séminaire de recherche 1, 2 et 3), l’examen général de synthèse et l’approbation scientifique de son projet de la part de la faculté des sciences infirmières, il a obtenu l’approbation éthique puis finale de son projet en avril 2025 et débuté la collecte de données en mai 2025 pour une durée maximale de 6 mois. Son projet est soutenu par plusieurs bourses d’excellence et de financement, dont la prestigieuse bourse doctorale du Fonds de recherche du Québec – Santé, ainsi que par le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l’Université de Montréal, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) et l’Observatoire en justice et santé mentale.
[1] Paradis-Gagné E, Pariseau-Legault P, Goulet MH, Jacob JD, Lessard-Deschênes C. Coercion in psychiatric and mental health nursing: A conceptual analysis. Int J Ment Health Nurs. 2021;30(3):590‑609.
[2] Hotzy F, Jaeger M. Clinical relevance of informal coercion in psychiatric treatment: A systematic review. Front Psychiatry. 2016;7:197.
[3] Potthoff S, Gather J, Hempeler C, Gieselmann A, Scholten M. “Voluntary in quotation marks”: A conceptual model of psychological pressure in mental healthcare based on a grounded theory analysis of interviews with service users. BMC Psychiatry. 2022;22(1):186.
[4] Allison R, Flemming K. Mental health patients’ experiences of softer coercion and its effects on their interactions with practitioners: A qualitative evidence synthesis. J Adv Nurs. 2019;75(11):2274‑84.
[5] Thomas J. Doing critical ethnography. Sage Publications; 1993. 96 p.
[6] LeFrançois BA, Menzies R, Reaume G, éditeurs. Mad matters: A critical reader in canadian Mad studies. Canadian Scholars’ Press; 2013. 394 p.
[7] Tracy SJ. Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry. 2010;16(10):837‑51.
Dessin: Alain Signori