De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Pour Roland Gori, cela ne fait aucun doute : la dé-civilisation n’est pas le fait de « sauvageons », de « barbares » héritiers d’une civilisation des « enfants rois » ou de « banlieusards » violents par nature ou par traditions émeutières. Aujourd’hui, la brutalisation des rapports sociaux et l’extrême violence des agressions ordinaires doivent être appréhendées sous l’angle d’une société qui sacrifie la culture du dialogue et empêche les processus de penser au profit d’une civilisation des mœurs. Une note de lecture proposée par le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan.
Le monde retient son souffle. C’est aujourd’hui, ce 2 avril 2025, le « jour de la libération » qu’il a dit. Son grand projet de hausse des tarifs douaniers, qui fera long feu…. N’a-t-il pas affirmé, il y a peu, que « droit de douane est le plus beau mot du dictionnaire » ? Des experts ont dressé un tableau clinique alarmant de ce milliardaire amoureux des droits de douane. Vous savez, celui qui assurait qu’il serait « dictateur, mais seulement le premier jour ». Le 47e président des Etats-Unis d’Amérique, puisque vous l’avez bien entendu reconnu, a été qualifié de psychopathe, de paranoïaque, Marie-France Hirigoyen, grande spécialiste française « es harcèlement et violences en tout genre » l’a formellement diagnostiqué narcissique pathologique. David Owen, pardon Sir David Owen, neurologue mais surtout ancien ministre britannique des Affaires étrangères, a même identifié chez lui ce qu’il nomme la « mendacité hubristique », une nouvelle entité nosographique, bon pas encore répertorié comme pathologie mentale par le DSM V mais bien dans l’air du temps, et qui correspondrait à « la pratique systématique du mensonge couplée à une démesure pathologique ».
Tout a été dit sur l’abominable Donald Trump, n’est-il pas une des figures politiques les plus clivantes de l’histoire contemporaine ? Des philosophes (Alain Badiou, Trump, PUF), des journalistes (Naomi Klein, Dire non ne suffit plus – Contre la stratégie du choc de Trump, Actes Sud), des politologues ( Nicole Bacharan, Le monde selon Trump, Tallandier), des intellectuels ( François-Emmanuël Boucher, Le Trumpisme: Contribution à l’analyse rhétorique du discours national-populiste, Presses de l’Université Laval), se sont penchés sur son cas. Rappelez-vous, Philip Roth le traitait de « menteur compulsif, ignorant, fanfaron, un être abject animé d’un esprit de revanche et déjà quelque peu sénile ». D’autres ont affirmé que le « disruptor in chief » était misogyne, raciste, homophobe, haineux, climatosceptique, protectionniste, anti-social, va-t-en-guerre, populiste, fasciste, enfin bref, le président des Etats-Unis apparait bien comme le genre d’énergumène qui accumule tous les défauts et à qui on ne peut reconnaître aucune qualité, « le genre de mec patibulaire, tu vois, mais presque ! » aurait certifié Coluche.
Symptômes de nos histoires collectives
On en a dit aussi beaucoup sur Bolsonaro au Brésil, Modi en Inde, Milei en Argentine, Netanyahu en Israël, Orban en Hongrie, Meloni en Italie… Oublions Poutine ou Xi Jinping. Ayons une pensée émue pour Marine Le Pen, rattrapée par la justice (et non par les juges) et dont la condamnation ce lundi 31 mars 2025 à cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics a été violemment contestée par toutes celles et tous ceux cités plus haut. L’« internationale réactionnaire » qui inquiétait le Président Macron en début d’année, s’en prend allègrement, partout de par le monde, à l’état de droit, à l’institution judiciaire, aux valeurs démocratiques et sociales, à la solidarité internationale…
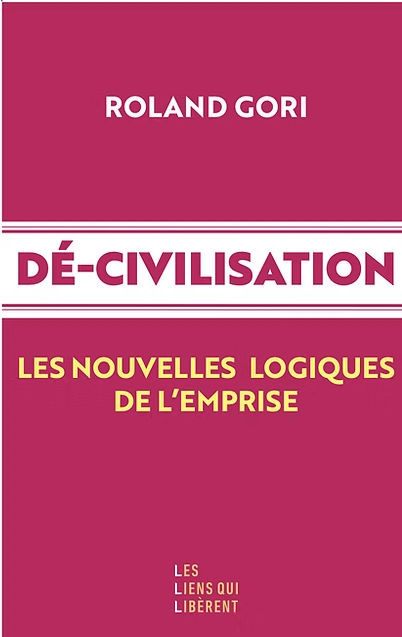
Mais convient-il vraiment de réduire la carte mondiale des régimes illibéraux à quelques éléments de la psychopathologie de leurs gouvernants ? Ne faudrait-il pas essayer plutôt d’y comprendre quelque chose au monde, nous, vous, qui les avons créés ? Trump et tant d’autres ne sont pas des erreurs de l’histoire, des singularités de contexte, ils ou elles sont les symptômes de nos histoires collectives. C’est pour cela qu’aujourd’hui, le jour de la libération, il faut lire et relire le dernier ouvrage de Roland Gori, Dé-civilisation. Les nouvelles logiques de l’emprise qui nous propose une réflexion saisissante sur l’état de nos sociétés contemporaines, marquées par la montée du populisme, la dégradation de la parole politique, l’érosion des repères symboliques et une fragmentation du lien social de plus en plus sensible, un état qu’il décrit comme en proie à un processus inquiétant de dé-civilisation, réhabilitant par là même un concept clé de la pensée du sociologue allemand Norbert Elias pour qui civilisation rimait avec civilités.
« Tant a été dit, donc, sur Trump et sur ses acolytes d’Outre Atlantique et d’Europe, qui veulent éteindre les Lumières et mettre en pièces tous nos idéaux de liberté, de justice sociale, d’inclusion et de cohésion ».
L’illustration d’un profonde crise des valeurs
Roland Gori est psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l’université d’Aix-Marseille. Membre d’ « Espace analytique » et président de l’Association « Appel des appels », il est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages parmi lesquels La fabrique de nos servitudes (LLL, 2022), Et si l’effondrement avait déjà eu lieu. L’étrange défaite de nos croyances (LLL, 2020), L’individu ingouvernable (LLL, 2015), où il pourfend, inlassablement, la société néolibérale et la technocratie du capitalisme, et défend, infatigablement, un projet de société plus juste, plus ouverte, plus accueillante et bien-traitante, plus « vivante » au sens d’Edouard Glissant qui est un auteur qu’il affectionne. Ses thèses résonnent avec les réflexions d’un certain nombre de penseurs qui ont, eux aussi, ont analysé la crise des valeurs et des institutions dans nos sociétés modernes, d’Herbert Marcuse (L’Homme unidimensionnel, 1964) à Jean Baudrillard (La Société de consommation, 1970), Zygmunt Bauman (La Modernité liquide, 2000), Pierre Bourdieu (La Distinction, 1979), Michel Foucault (Surveiller et punir, 1975), et d’autres… Tous ont pu montrer comment les transformations sociétales récentes ont conduit à une érosion du lien social et des structures symboliques, au détriment de la cohésion collective et du sens commun. Roland Gori s’inscrit, comme pour chacun de ses livres, dans un foisonnant dialogue intellectuel convoquant les anciens et les modernes, la littérature et les sciences humaines, la politique et l’économie, Freud et Camus, Norbert Elias et Montesquieu : Dé-civilisation se situe ainsi dans cette même tradition critique qui dénonce les effets déshumanisants du néolibéralisme et des idéologies de marché, et qui atteste que la régression ici évoquée n’est surement pas seulement sociale, mais aussi symbolique et psychique.
Ce que Roland Gori rappelle assidument, dans ce que l’on doit bien appeler son œuvre, tant son parcours et ses ouvrages s’entrelacent en tissant entre eux une véritable concordance et cohérence, c’est que nos sociétés modernes, marquées par l’individualisme, la marchandisation des relations humaines et la dégradation des institutions collectives, sont en proie à cette dé-civilisation qui fragmente nos repères symboliques et attise une incontestable crise de ces valeurs que nous partageons et qui soutiennent notre vivre-ensemble. Cette crise, qui affecte non seulement les individus, mais aussi le tissu social et politique, crée un environnement qui nous laisse toutes et tous, désorientés et désemparés. Comment dès lors sortir de cette régression collective, où les principes fondamentaux qui ont structuré nos sociétés civilisées se dissolvent et comment reconstruire nos repères et réaffirmer l’autorité symbolique pour restaurer le lien social et, du coup, la civilisation elle-même ?
« Dé-civilisation atteste que la régression ici évoquée n’est surement pas seulement sociale, mais aussi symbolique et psychique. »
Un effondrement culturel et civilisationnel
Si dans ses précédents ouvrages, Gori évoquait déjà la manière dont nos sociétés modernes réduisent l’individu à un simple produit de l’économie, un consommateur sans identité réelle, manipulable et sans repères, soumis à une forme pernicieuse de servitude volontaire, dans Dé-civilisation, il explore ces mécanismes à plus large échelle, rappelant combien ces processus d’individualisation ont conduit à une déstructuration du lien social et à une dégradation des valeurs communes. Gori commence par dresser un tableau clinique de notre époque et de notre civilisation occidentale. Pas réjouissant le tableau : violences, perversions, manipulations, mensonges, exclusions, brutalité des rapports sociaux, qui deviennent des rapports de force et de pouvoir, haine, rejet, peur… Du vacarme partout, du tumulte, des fake news, des faits divers sordides, des guerres locales, régionales, pourquoi tant de violence, omniprésente, au quotidien ? Il serait simple et si confortable de trouver des coupables, de nouveaux barbares, des fauteurs de trouble, mais Gori insiste : c’est sous l’angle de la société toute entière qu’il convient d’appréhender ces effondrements culturels et civilisationnels et même ces dévoiements du langage.
Gori met d’ailleurs en garde, « dé-civilisation » n’est pas ensauvagement, trop commode manipulation du langage, si prestement corrompu aujourd’hui par les politiques de tout bord. Roland Gori nous indique d’emblée que penser demande des efforts et qu’il convient de restaurer le sens des mots et leur histoire. Il nous engage aussi à nous garder du primat de l’émotion et de la subjectivité qui l’emporte si vite sur la raison et les valeurs communes, transformant la société en une collection d’individus désorientés et divisés. Et à réinventer des conditions sociales et culturelles qui nous permettent de penser, de partager le sensible et de vivre de commun.
Gori identifie ce processus de dé-civilisation non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans celui de la culture, du soin ou de l’éducation. Ainsi, s’il n’hésite pas à pointer du doigt les élites politiques, qu’il accuse de ne plus être à la hauteur des enjeux de civilisation et d’avoir abandonné les grands idéaux de la République au profit de calculs bassement électoralistes, il met également en lumière la responsabilité des médias, des intellectuels, et de la culture dominante dans cette dérive, qui cherche plus à flatter qu’à éclairer, à divertir plutôt qu’à élever. On retrouve là la critique radicale de l’abandon de la parole publique au profit du spectacle médiatique et de la manipulation des masses.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, Dé-civilisation n’est pas un précis nostalgique, regret d’un âge idéal, ni même la peinture d’une désolation planétaire ni encore l’annonce de jours terribles à venir. Non, il y a dans cet ouvrage et d’ailleurs dans toute l’œuvre de Gori, un engagement à aller de l’avant, à croire, à espérer. Ni résignation ni peine ni colère. Juste cette assurance presque sereine que le monde change, que toute civilisation traverse ces moments de fragilité et de trouble, mais qu’elle leur survit si elle sait se réinventer, transcender l’angoisse pour faire germer l’espoir et surtout, surtout, résister aux « sirènes de l’emprise ». Il n’y a pas de solutions simples pour se déprendre de cette dé-civilisation ; il s’agit plutôt d’un travail de reconstruction progressive, exigeant à la fois un retour à la pensée critique, une introspection collective et une réévaluation de nos structures mentales et sociales.
« Dé-civilisation n’est pas ensauvagement, trop commode manipulation du langage, si prestement corrompu aujourd’hui par les politiques de tout bord. »
Progresser malgré la régression
Dé-civilisation de Roland Gori ne nous épargne pas. L’ouvrage met des mots, forts, vrais, sur notre monde contemporain. Il interroge notre place en tant qu’individu dans cette société de plus en plus atomisée et déstructurée, et nous engage à une réflexion stimulante sur ce qui reste de nos grandes idéaux civiques. L’auteur fait alors un pari audacieux : celui de renouer avec un idéal de civilisation tout en dénonçant la régression qui s’opère sous nos yeux, en n’épargnant aucune illusion et en nous invitant à une prise de conscience salutaire. Difficile mais indispensable labeur. Libérateur ?
• Note de lecture de Patrick Ben Soussam, pédopsychiatre à Marseille, de l’ouvrage de Roland Gori, Dé-civilisation. Les nouvelles logiques de l’emprise, Les liens qui libèrent, février 2025.












