Avec la parution de son livre Le faisceau des vivants, Catherine Zittoun, pédopsychiatre, nous fait voyager dans les plis de l’histoire et ouvre une fenêtre sur la vie dans les asiles d’aliénés sous l’Occupation.Tant que les patients juifs étaient maintenus hospitalisés, ils restaient à l’abri de l’arrestation et de la déportation. Entretien.
Pouvez-vous nous éclairer sur le sort des patients de confession juive internés à l’hôpital psychiatrique pendant l’Occupation ?
Catherine Zittoun : On connait plus ou moins le sort terrible qui s’abattit sur les malades psychiatriques pendant l’Occupation. 45 à 50 000 aliénés moururent alors de faim, de privation, de froid, de carence de soins, sauf dans quelques lieux. Ainsi à Saint-Alban en Lozère, dirigé par Lucien Bonnafé et François Tosquelles, on s’organisa, on fit communauté – ce furent les débuts de la psychothérapie institutionnelle- et les patients échappaient au rationnement drastique en cultivant des potagers et en générant leurs propres ressources alimentaires.
Mais on connait très peu le sort réservé aux internés de confession juive. Ce pan de l’histoire de l’occupation et de la Shoah mérite d’être mis en lumière. Les patients maintenus internés pendant l’Occupation furent sauvés de la déportation tandis que furent déportés les patients juifs déclarés rétablis et sortant de l’hôpital psychiatrique.
Les médecins des hôpitaux étaient priés par la Préfecture de Police de Paris de la tenir informée des patients de confession israélites internés ou sortant de l’hôpital ; ceux-ci étaient alors invités par les médecins à se présenter à la Préfecture pour « régularisation de leur situation d’étranger ». Des documents d’archive nous font découvrir la suite. Ainsi le patient O.C. venu du camp de Drancy, y est réintégré après 14 mois d’internement à Saint-Anne. Il est déporté 5 jours plus tard à Auschwitz. Ou Madame S., sortante le 31 mai 1942 après 3 mois d’internement à Sainte-Anne, fait partie du convoi n°37 du 25 septembre à destination d’Auschwitz.
A contrario, la patiente Fanny P. internée le 6 aout 1942 pour un état délirant à thèmes de persécution, est maintenue hospitalisée jusqu’en 1944. En 1943, le médecin certifie qu’elle « présente un état délirant qui, actuellement, contre-indique sa conduite au commissariat de police ainsi que son interrogatoire par les services de police. ». Ce séjour à l’hôpital l’a incontestablement sauvée de la déportation. Autre cas exemplaire, celui de Golda K., décompensant un trouble psychiatrique quand son mari et son fils sont emmenés par la police. A l’examen initial en mai 1943, Georges Heuyer, médecin chef de l’Infirmerie Psychiatrique de la préfecture de Police, précise que son état justifie le placement pour « mélancolie… tristesse, asthénie, idées de suicide ». A son entrée à l’hôpital, le médecin note que « son mari et son fils aîné sont actuellement au camp de Drancy ». Dans les mois qui suivent, on apprend qu’elle « fait du tricot, travaille à la couture, aux épluches, au triage des haricots, au raccommodage des bas ». Elle sort de l’hôpital le 6 janvier 1945, seule survivante de sa famille. C’est à la prolongation de l’internement, au cours duquel elle s’est d’ailleurs rapidement améliorée, qu’elle doit son salut.
Ainsi, tant qu’ils étaient maintenus hospitalisés, les Juifs étaient à l’abri de l’arrestation et de la déportation. Mais ils n’ont pas été épargnés par les mesures visant à les spolier de leurs biens matériels. Destiné à recenser les malades internés de confession israélite, un imprimé pré-rempli était adressé à l’administrateur provisoire des biens des aliénés. Les dispositions protectrices des biens prévues par la Loi sur les aliénés étaient alors détournées voire violées.
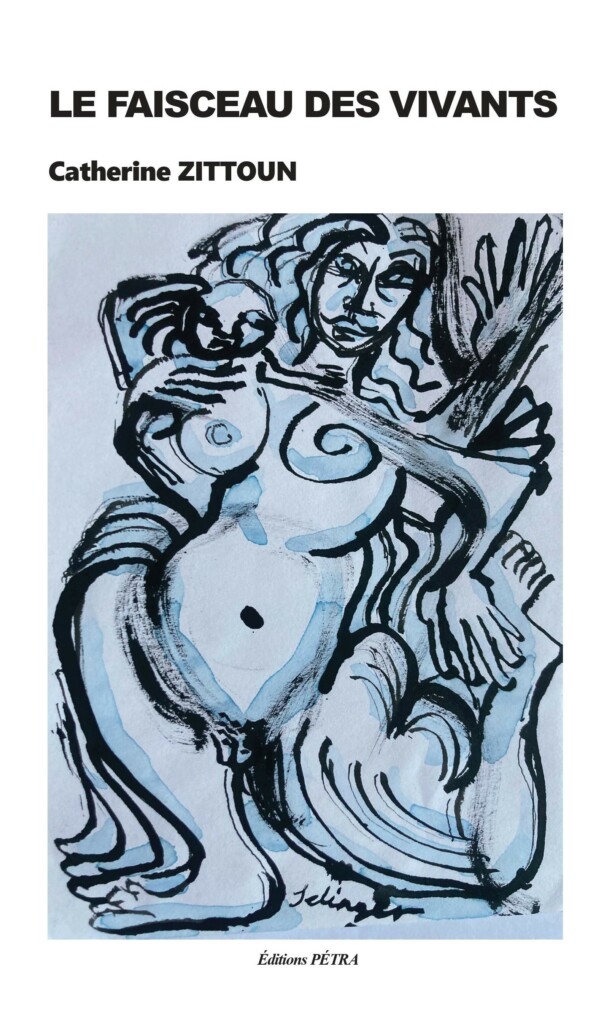
Votre livre est le récit de l’enquête acharnée que mène Sophie à la mort de sa mère pour renouer le fil de ses origines et le partager avec sa fille Alice. Une histoire de secret, de silence et de traumatisme transgénérationnel ?
Catherine Zittoun : Le faisceau des Vivants entrecroise deux chemins, celui d’Aimée et celui de Max. Tous deux enfants juifs cachés pendant la guerre, Aimée et Max tentent chacun à leur façon de surmonter ce passé. Reconstituant tardivement son histoire, Max se construit une généalogie avec difficulté. Sa mère a rompu les liens avec lui quand elle l’a confié à l’état pour le sauver de la Shoah. Traumatisée par la guerre, elle n’a pu, par la suite, renouer avec son fils.
Jusqu’au seuil de sa vie, Aimée garde le secret de ses origines. Sur son lit de mort, elle révèle à sa fille Sophie que, contrairement à ce qu’elle lui a dit, sa grand-mère Claire n’est pas morte en déportation. Et Aimée meurt, laissant Sophie seule face à cette vérité, tel un gouffre soudain ouvert. Sophie se lance dans une enquête quasi-policière sur les traces de ce passé enfoui. Elle mène cette recherche autant pour elle que pour sa fille Alice à laquelle elle transmettra plus tard ce qu’elle a reconstitué de l’histoire familiale. Car, dit-elle, elle doit offrir à sa fille un sol suffisamment solide sur lequel Alice pourra s’avancer et s’élancer vers son avenir.
Pour savoir où tu vas, il faut se souvenir d’où tu viens, disent les anciens. Ainsi, quand on élève un enfant, est-il important de lui transmettre l’histoire de ses ancêtres, telle qu’à chaque génération on la reconstruit. Mais ce n’est pas toujours facile. On sait ainsi que les survivants de la Shoah, pour beaucoup, se sont tus. A ceux qui tentaient d’en parler, on faisait comprendre que le silence était préférable. En France, ce passé était intolérable pour tous et risquait d’ouvrir les failles de la collaboration. Pour des raisons plus personnelles (culpabilité du survivant, honte, psychotraumatisme, déni,…) beaucoup de survivants de la Shoah ne pouvaient en parler, ou alors très tardivement. C’est quelque chose dans tous les cas qui reste en eux jusqu’au bout. Plus rares sont ceux qui en parlent. Je me souviens de Jules Fainzang avec qui j’accomplis ce pèlerinage à Auschwitz Birkenau. Survivant de la Shoah, Jules accompagnait trois fois par an des voyages sur ces sites et témoignait. Tout le trajet de Cracovie à Auschwitz, ce petit monsieur magnifique et âgé, debout dans l’autocar, parlait fort dans le micro et racontait, le wagon à bestiaux, la descente du train, les cris des Allemands, les aboiements des chiens et racontant il se mettait à crier ; à l’évidence il était transporté sur la scène du crime.
D’autres survivants, tels Shelomo Selinger [1], sculpteur, ont sublimé ce traumatisme à travers leur art. Les sculptures de Shelomo en bronze, bois ou granit sont des représentations de l’amour et de la maternité. Les dessins de Shelomo, pour certains, portent la mémoire des marches de la mort et des exactions de la Shoah.
Qu’il soit gardé secret, abréagi, surmonté ou sublimé, ce traumatisme reste à jamais inscrit dans la mémoire des survivants, de leurs enfants mais aussi dans l’inconscient familial et pouvant ainsi affecter, par des jeux d’identification et/ou de projection, les générations suivantes. J’ai rencontré à quelques reprises une fillette qui, à l’évidence, portait des symptômes entrant dans le spectre autistique (grande rigidité de pensée, difficulté à gérer ses émotions, troubles des interactions sociales, en famille surtout, sentiment d’injustice et jalousie poussée à l’extrême). Les relations étaient particulièrement difficiles avec son père qui se plaignait de sa violence verbale et physique et qui parlait d’elle comme d’un quasi monstre qui le persécutait. Rapidement la fillette n’a plus voulu venir en consultation mais j’ai suivi longtemps ses deux parents et je suis encore son père, la mère ayant déclaré que la fillette devenue adolescente se porte mieux. Lors des consultations en face à face, son père a révélé que son arrière-grand-père maternel, déporté, était mort à Auschwitz. Quant à sa mère, elle apprit très tardivement ses origines juives. A lui, ces révélations à l’âge de 18 ans agirent comme un traumatisme. Et il apparait que sa fille est pour son père une surface de projections de fantasmes mortifères.
Ces transmissions transgénérationnelles du traumatisme ne se limitent pas à la Shoah. Beaucoup des jeunes patients que nous soignons sur le 19è arrt de Paris sont porteurs de Troubles du spectre autistique. Pour certains, il y a à l’évidence un lien entre le trouble de l’enfant et le passé des parents – il s’agit souvent de familles monoparentales. Ceux-ci ont vécu des événements traumatiques, tels que la perte d’un enfant ou, pour les migrants, des traumatismes dans le pays d’origine ou lors de la migration. Ces traumatismes psychiques agissent comme un aimant dans la relation à l’enfant en bas âge et soustraient le parent à des interactions précoces de qualité et nécessaire au développement
Poétesse, ce livre est votre premier roman, pourquoi ce livre maintenant ? (roman autobiographique ?)
Catherine Zittoun : Poétesse, je le suis depuis l’enfance. A l’école primaire, j’étais toujours volontaire pour réciter les poésies car je voulais faire partager à mes camarades les émotions que je ressentais à la lecture du poème. Etre poète, ça ne participait pas d’une quelconque volonté de ma part. C’est plutôt les poèmes qui me choisissaient pour les mettre en voix. Ils passaient par moi. Rapidement je me suis mise à écrire de la poésie et encore plus à l’adolescence, c’était une nécessité. Au sortir de l’adolescence, des envies se bousculaient dans ma tête, envies de voyage, envies de rencontrer des peuples et des cultures, envies de soigner, d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents. Bref mille choses m’attiraient et des histoires aussi que je voulais raconter. J’avais idée d’écrire des romans. Mais la vie me menait ailleurs, des articles scientifiques, de recherches en psychiatrie, des rencontres avec des artistes qui m’ont conduite vers la mise en scène de théâtre -j’ai fait alors partie des pionniers des spectacles multimédia- puis vers les livres d’artistes. J’ai pu réaliser, grâce à l’éditeur Bernard Dumerchez, et d’autres éditeurs aussi, des livres d’artistes avec Zao Wou-Ki, Vladimir Velickovic, Takesada Matsutani, Emmanuel Fillot, d’autres artistes aussi. Ça laissait peu de temps pour l’écriture d’un roman.
Un jour, Michel Caire, historien de la psychiatrie, me mit sur la piste de ces patientes juives cachées pendant la guerre dans les hôpitaux psychiatriques. Ce pan de l’histoire m’était alors inconnu mais résonnait en moi d’une curieuse façon. Dans la même période, je perdis ma grand-mère Claire, une très belle personne. Alors petit à petit s’imposa cette évidence : j’écrirais ces histoires de ces patientes sauvées de la Shoah, et de leurs enfants, pour beaucoup enfants juifs cachés pendant la guerre dans des familles d’accueil. Responsable pendant 20 ans d’un accueil familial thérapeutique, j’étais également très sensible à ces problématiques. Et un jour quelque chose de plus fort que moi me poussa vers l’écriture du roman, métier à tisser des histoires. Etait-ce aussi un tombeau que je façonnais pour ma grand-mère ? En hébreu, les mots : « le nom » et « l’histoire » ont la même valeur numérique. L’histoire serait ainsi un navire qui, d’une certaine façon, maintient en vie nos défunts.
[1] Shelomo Selinger est l’auteur du dessin de couverture du Faisceau des Vivants












