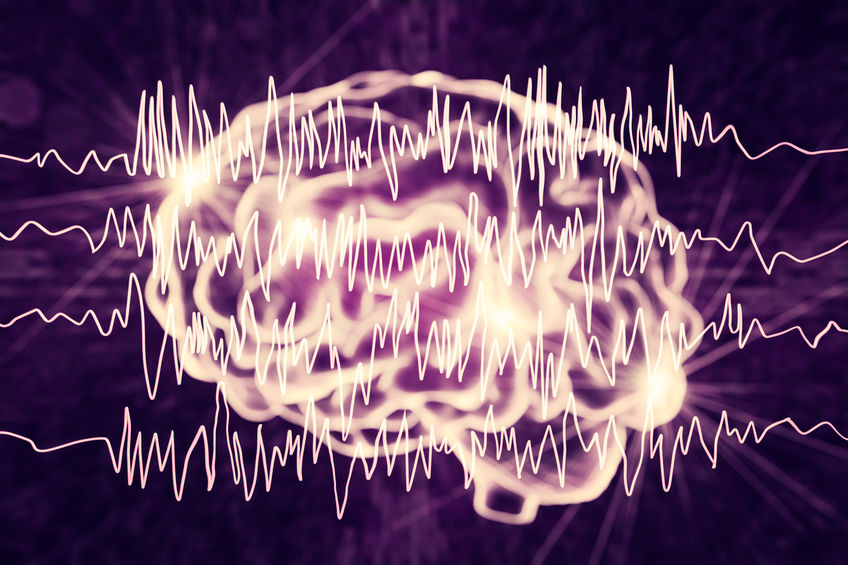WhatsUp neuropsychologie clinique a rencontré Sophie Pradier, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie qui accompagne des patients épileptiques pharmaco-résistants dans le cadre d’un parcours de chirurgie. Sophie travaille au sein de l’Unité de Vidéo EEG du Service de Neurophysiologie Clinique de l’Enfant et l’Adulte – Pôle Neurosciences Cliniques Groupe Hospitalier Pellegrin – CHU Bordeaux. Le 14 Novembre prochain elle interviendra au e-congrès WhatsUp Neuropsychologie Clinique sur le thème « Diagnostic préopératoire en épilepsie« .
WhatsUp Neuropsychologie Clinique : Comment les professionnels de santé se représentent-ils les troubles cognitifs dans l’épilepsie ?
Sophie Pradier : Quand on parle d’épilepsie, les premières représentations qui émergent sont généralement autour des notions de crises et de convulsions. Bien que les troubles cognitifs fassent partie intégrante de la définition des épilepsies portée par la ligue internationale contre l’épilepsie, les professionnels de santé restent peu informés sur ces différents types de troubles et leurs répercussions.
WU : Quelle sont la fréquence et l’impact de ces troubles cognitifs chez ces patients ?
SP : Les troubles cognitifs, fréquents dans les épilepsies, sont objectivés dans différents domaines (principalement la mémoire, l’attention, les fonctions exécutives). Jusqu’à 70% des patients adultes en souffrent dès le début de la maladie. Il est donc important de les documenter le plus tôt possible afin d’apprécier leur évolution et de les prendre en charge si nécessaire, du fait de leurs conséquences sur la qualité de vie des patients (retentissement scolaire, insertion socio-professionnelle, observance du traitement, perte de l’estime de soi).
WU : Pourquoi réaliser un bilan neuropsychologique préopératoire ?
SP : Le bilan est indispensable à l’évaluation du retentissement cognitif avant la chirurgie des épilepsies focales afin d’établir une ligne de base à comparer en post-opératoire (voir encadré ci-dessous). Selon les résultats, les éventuels déficits cognitifs et/ou comportementaux relevés peuvent contribuer à orienter vers une latéralisation et une localisation de la zone épileptogène. Le bilan intervient également dans la réflexion sur le devenir cognitif postopératoire du patient en fonction de la capacité de réserve mentale, c’est-à-dire la capacité à compenser à l’aide des fonctions cognitives résiduelles.
WU : Quelle place occupez-vous auprès de vos collègues qui ne sont pas psychologues ?
SP : L’Unité de Vidéo-EEG est particulière dans le sens où l’équipe médicale et paramédicale travaille dans le même espace, la salle d’interprétation. Cela favorise grandement les échanges informels et permet d’apporter un éclairage neuropsychologique et psychologique sur le fonctionnement des patients.
WU : Que trouvez-vous de stimulant dans ce poste ?
SP : Pour chaque patient candidat à une chirurgie, la réflexion issue des différents examens, dont le bilan neuropsychologique, est passionnante. Il s’agit de confronter en équipe pluridisciplinaire l’ensemble des données afin de déterminer leur concordance – ou non – sur une zone épileptogène précise. Une véritable enquête !
La chirurgie de l'épilepsie
Actuellement, plus de 70% des patients épileptiques sont stabilisés par leur traitement, c’est-à-dire qu’ils ne font plus de crise depuis plus d’un an. Dans la grande majorité des cas, ils peuvent alors mener une vie normale avec quelques précautions, la prise du traitement et une vie régulière en évitant en particulier le manque de sommeil. De même, la prise du traitement impose des précautions par exemple au cours de la grossesse, certains médicaments étant tératogènes. Mais 25 à 30% des cas ne seront pas stabilisés par un traitement médicamenteux, et garderont des crises invalidantes. On parle alors de pharmaco-résistance. Dans certains de ces cas, il est possible d’envisager un traitement chirurgical (chirurgie de l’épilepsie). Il s’agit d’une procédure complexe réservée à des centres spécialisés et expérimentés. Le principe est de pouvoir retirer la région du cerveau qui est à l’origine de toutes les crises présentées par le patient.
Ce type d’opération n’est possible que si deux conditions sont préalablement vérifiées, qui font l’objet du bilan préchirurgical (qui peut durer plusieurs mois, du fait des précautions nécessaires) :
- Parvenir à établir de façon certaine que l’ensemble des crises épileptiques présentées par le sujet proviennent d’une seule et même région cérébrale, dont les contours sont bien délimités. Le défaut de respect de cette première condition peut conduire à l’échec thérapeutique, le patient continuant de présenter des crises après le geste chirurgical, du fait de la présence persistante de tissu épileptique.
- Parvenir à établir de façon certaine que l’exérèse de cette région cérébrale « épileptique » ne va entrainer aucun déficit neurologique (en dehors de certains déficits peu invalidants qui peuvent être acceptés par le patient avant la chirurgie, comme une amputation d’une partie limitée du champ visuel) ou neuropsychologique (langage, mémoire). Il s’agit parfois d’une étape difficile, notamment lorsque la « région épileptique » est proche de zones fonctionnelles importantes. La chirurgie de l’épilepsie concerne les adultes et les enfants, et ne nécessite par la présence d’une lésion cérébrale objectivée par l’IRM. En revanche, elle ne peut pas être considérée dans le cas des épilepsies partielles « idiopathiques », dont la grande majorité connait une guérison spontanée, et a fortiori des épilepsies généralisées. Cette procédure, qui parait lourde et coûteuse, est cependant « remboursée » au bout de 4 ans, comme l’a montré une étude médico-économique réalisée en France.
Il existe également des procédures chirurgicales dites « palliatives », dont l’objectif est la réduction de la fréquence et/ou de l’intensité des crises. Ces procédures, comme la stimulation du nerf vague, ne visent pas la guérison de l’épilepsie, mais une amélioration de la qualité de vie. Elles sont également réservées aux épilepsies pharmaco-résistantes, lorsque la chirurgie de l’épilepsie curative (décrite plus haut) est rendue impossible.
Il existe également des procédures chirurgicales dites « palliatives », dont l’objectif est la réduction de la fréquence et/ou de l’intensité des crises. Ces procédures, comme la stimulation du nerf vague, ne visent pas la guérison de l’épilepsie, mais une amélioration de la qualité de vie. Elles sont également réservées aux épilepsies pharmacorésistantes, lorsque la chirurgie de l’épilepsie curative (décrite plus haut) est rendue impossible.
Source : services de neurologie et neurochirurgie du CHU de Bordeaux - Mars 2017