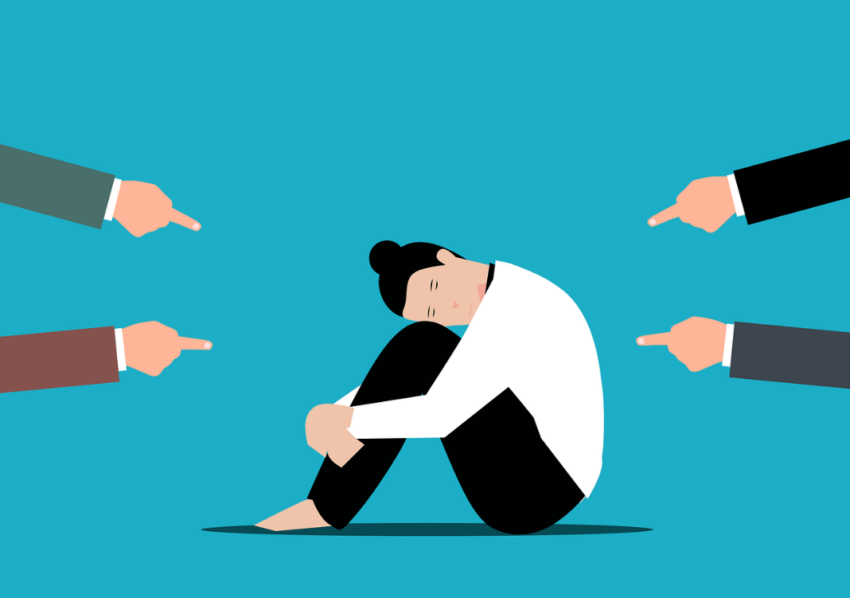Contrairement aux animaux, commandés par leur instinct, l’être humain peut faire ce qu’il veut. Ce qui suppose une société produisant des choses à vouloir et à penser, au-delà du nécessaire naturel. Or ce surplus social exige un supplément de règles : incitatives, pour engendrer la liberté humaine de produire ce surplus, et punitives, pour limiter sa capacité d’en abuser. Ces lois sociales ne prennent plus alors la forme de commandements internes mais de recommandations externes, laissant le choix aux individus. Ces incitations normatives sont de nature objective et subjective : récompense et sanction d’un côté, bonne conscience et culpabilité de l’autre.
La culpabilité pose dès lors trois questions. Celle de sa cause tout d’abord : d’où vient l’inconséquence d’accomplir des actes qu’on regrette ? Celle de son inadéquation ensuite : pourquoi certains « méchants » ne l’éprouvent-ils pas, quand certains justes en sont écrasés ? Celle de sa réalité enfin : n’est-elle que l’onde de choc cérébrale d’une habitude contrariée, ou témoigne-t-elle de notre accès à une loi supérieure ?
La force de la morale
« Je vois le bien et je fais le mal (1) ». Nous avons tous fait cette expérience d’agir contre notre propre jugement. Comment expliquer que nous soyons déchirés entre un bien qu’il faut faire (manger sobrement, pardonner, payer ses impôts…) et le bon qu’on veut obtenir (se régaler, se venger, s’enrichir…) ?
On peut analyser cette contradiction à travers l’opposition classique entre l’esprit et le corps : l’esprit voit le bien à distance tandis que le corps saisit son plaisir immédiat. Entre une source pure mais exigeante et un estuaire saumâtre mais jouissif, les individus penchent naturellement vers l’aval. La culpabilité s’engouffrerait alors entre ce qu’il aurait fallu faire et ce qu’on a fait, selon une sorte de morale des vases communicants. Seulement la morale n’a pas la force des lois physiques, et l’on peut inverser l’analyse. Si « nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés (2) », la morale serait simplement une hypocrisie servant nos intérêts à long terme. Un commerçant trouvera ainsi plus d’intérêt à être honnête pour investir à long terme dans la réputation de son entreprise, qu’à filouter quelques clients inattentifs. La culpabilité est ainsi une notion équivoque, qui peut désigner une force nous ramenant au droit chemin comme une simulation camouflant nos embardées.
Un conditionnement social
Comment comprendre ensuite que la plupart des « méchants » n’éprouvent pas de culpabilité, quand des innocents la ressentent plus qu’à leur tour ? Si ce sentiment n’est pas toujours corrélé à la faute, c’est qu’il provient davantage de l’individu que de la situation, des intentions que des actions. Sidérée par l’absence de sentiment de culpabilité du haut dignitaire nazi Eichmann à son procès, Hannah Arendt l’expliquait par une habitude de l’atroce, évoquant la « banalité du mal (3). » La culpabilité serait un conditionnement social, et non un sentiment naturel. C’est ainsi que Freud conçoit l’esprit comme le négociateur entre les idéaux sociaux, imposés par le « surmoi », et les revendications pulsionnelles du « ça » (4), la culpabilité étant à la fois l’effort et l’échec de la diplomatie psychique. Ce qui explique que les gens les plus consciencieux s’accusent à tort, tandis que les vilains se flattent de leurs méfaits : les uns ont un surmoi survolté par une éducation disciplinée tandis que les autres un surmoi anémié par une éducation laxiste.
Des valeurs universelles
Et pourtant, la saisie même d’un décalage entre culpabilité et faute suppose un espace « objectif » où elles se chevauchent. Notre capacité à négocier, non seulement avec notre pulsion, mais aussi avec notre culpabilité, exige un étalon indépendant de l’une et de l’autre. C’est la condition pour sortir d’un scepticisme moral qui pose le même problème que le scepticisme cognitif : pour juger de la relativité d’une croyance, il faut avoir l’idée de sa vérité au moins possible. L’inadéquation de la culpabilité à la faute fait signe vers un référent transcendant les systèmes particuliers de jugement, comme l’égalité des individus par exemple, ou encore toutes les grandes valeurs humaines, dont seul un relativisme de mauvaise foi peut remettre en cause l’universalité (5).
le rationnel et la morale
La culpabilité nous renvoie ainsi à notre double nature. Êtres rationnels qui dépassons aussi bien l’instinct que les conventions. Mais êtres moraux qui éprouvons le scrupule d’enfreindre des principes qui peut-être ne sont rien, ou peut-être nous tirent du néant en prouvant notre valeur. Le sentiment de culpabilité combine ainsi notre intelligence (qui nous soustrait aux lois naturelles et sociales) et notre dignité (qui nous fait porter le poids de la culpabilité, même impunis, et réclame l’expiation de ceux qui ne l’éprouvent pas). Elle est l’instinct du crime, qui mord notre humanité.
Guillaume Von Der Weid
Professeur de philosophie
1– Saint-Paul : Lettre aux Romains, VII, 14-25, La Bible, Pocket, 2005.
2– La Rochefoucault (Duc de) : Maximes, épigraphe, Livre de Poche, 1991.
3– Arendt (Hannah) : Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, Folio Histoire, 1997.
4– Freud, S. : Le moi et le ça, Œuvres complètes, t. XVI, PUF, 1991.
5– « Ô Montaigne ! toi qui te piques de franchise et de vérité, sois sincère et vrai si un philosophe peut l’être, et dis-moi s’il est quelque pays sur la Terre où ce soit un crime de garder sa foi, d’être clément, bienfaisant, généreux ; où l’homme de bien soit méprisable, et le perfide honoré. » Rousseau, J.-J. : Émile, Livre IV, « Profession de foi du vicaire savoyard », GF, 2009.