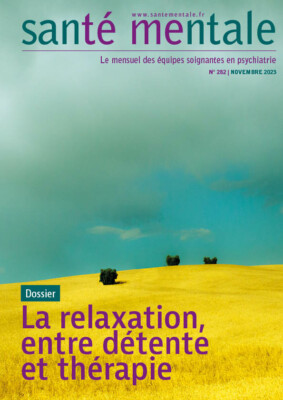Le terme « sophrologie » vient du grec sos, que l’on peut traduire par « sain », « harmonie » ; phren, par « esprit », « conscience » et logos, par « étude » « discours ». Ainsi, il signifie en quelque sorte « l’étude de l’harmonie de l’esprit » ou « l’étude de l’esprit en harmonie ».
La sophrologie s’inscrit dans le champ des méthodes de relaxation de type hypnotique car elle travaille à partir d’un état de conscience modifiée appelé niveau sophronique ou sophroliminal. Cet état de transe est obtenu par des suggestions de calme, de détente neuromusculaire, de tonus abaissé.
Elle possède de versant prophylactique, thérapeutique ou éducatif. Selon la perspective dans laquelle ils se trouvent, les professionnels de santé formés à cette méthode peuvent la proposer de façon plus appuyée dans un de ces axes.
Dès ses débuts, dans les années 1960, la sophrologie est ainsi entrée dans le domaine de compétences de différents professionnels de santé, d’abord dans les services de réadaptation fonctionnelle et de rééducation (médecins, kinésithérapeutes, psychologues et infirmiers…), en gynécologie et obstétrique (sages-femmes) puis rapidement en psychiatrie et enfin dans toutes sortes de services (neurologie, cardiologie, médecine interne…).
En psychiatrie, les indications les plus fréquentes sont le stress, qui peut mener à l’épuisement voire au burn-out, l’anxiété et la dépression. Les troubles psychotiques peuvent être accompagnés par la sophrologie mais les indications sont plus limitées et demandent une grande expertise du praticien. Cungi rappelle que « les indications thérapeutiques des méthodes de relaxation dépendent de l’état émotionnel dans lequel se trouve le patient et son intrication avec une éventuelle pathologie. »…
Pour poursuivre votre lecture
Connectez-vous à votre compte si vous êtes déjà client.