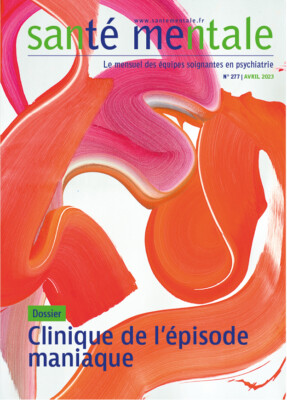Le trouble bipolaire (TB), dont la prévalence est estimée entre 2,4 et 6,5 % de la population générale est selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) une des 10 pathologies chroniques les plus invalidantes (Rowland et Marwaha, 2018). Le trouble se définit par l’alternance d’épisodes dépressifs caractérisés et de phases maniaques, hypomanes, parfois mixtes, entrecoupées de périodes de rémission partielle ou complète à durée variable. À l’instar de la schizophrénie, les arguments en faveur d’un modèle neurodéveloppemental de la maladie s’accumulent. Résultant de l’interaction entre une vulnérabilité génétique et certains facteurs environne- mentaux, le début des troubles se situe entre 15 et 25 ans. Durant cette période « critique », se jouent le développement de la personnalité et la séparation d’avec les parents, et se définit la trajectoire socioprofessionnelle. Ce stade représente en lui-même un stress pour l’adolescent et le jeune adulte. Entre 15 et 25 ans, les présentations cliniques des troubles bipolaires (TB) sont atypiques, souvent chaotiques. Les enjeux sont nombreux pour les patients et leurs proches, mais aussi pour le système de santé, en lien avec l’articulation délicate entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. Inspirée par les résultats plus que convaincants de l’intervention précoce dans la psychose (Correll 2018), cette approche appliquée aux TB est au centre de recherches enthousiasmantes (MacNeil2012).
Pour poursuivre votre lecture
Connectez-vous à votre compte si vous êtes déjà client.