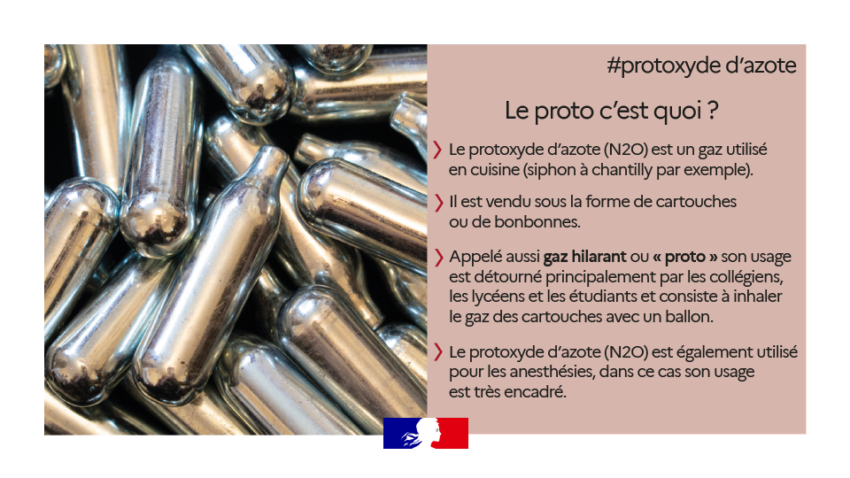Dans ce numéro de Tendances n°151, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) présente une enquête sur les motivations des consommateurs de protoxyde d’azote (gaz hilarant). Produit de «convivialité» s’intégrant souvent à des polyconsommations, il est particulièrement accessible et perçu comme présentant peu de risques sanitaires par les usagers, malgré le renforcement de la règlementation depuis 2018 et le déploiement de campagnes de prévention pour limiter son usage.
Depuis 2017, tant au niveau européen que français, ce phénomène fait l’objet de signalements d’usages dans l’espace public, d’une forte visibilité médiatique, de campagnes de prévention et de mesures législatives et réglementaires visant à restreindre l’accès au protoxyde d’azote.
Cette publication Tendances n°151 s’appuie sur des observations et des entretiens individuels réalisés auprès d’usagers abordés par le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’OFDT et par Sociotopie, atelier de recherche réunissant sociologues et anthropologues dans le cadre d’un projet financé par l’Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France. Comment s’inscrivent ces consommations dans les sociabilités juvéniles et festives ? Quelles perceptions des risques en ont les jeunes usagers ? Comment ont évolué les modalités d’accès à ce produit ? Des contextes d’usages «festifs » et une association systématique à d’autres substances psychoactives.
Les personnes interrogées indiquent consommer du protoxyde d’azote exclusivement lors de moments festifs et collectifs et rechercher une sensation, intense mais brève, d’« euphorie », de flottement ou de distorsion temporelle. Les pratiques de consommation prennent souvent des formes codifiées et ritualisées, par exemple lorsque, à plusieurs reprises au cours de la soirée, les ballons sont remplis de gaz les uns à la suite des autres puis consommés simultanément, de manière à obtenir une optimisation des effets puis une euphorie collective et synchronisée, à l’instar des jeux autour de l’alcool. Considéré comme étant « festif » et « convivial », le protoxyde d’azote est cependant presque toujours perçu comme un produit d’usage secondaire. Si ses effets sont appréciés à certains moments de la soirée c’est parce qu’ils viennent systématiquement compléter, amplifier ou relancer les effets d’autres substances psychoactives disponibles lors de la soirée, en particulier l’alcool et dans une moindre mesure les poppers, le cannabis ou des psychostimulants.
François, étudiant de 24 ans, témoigne : « Moi et mes amis on n’en faisait pas tant qu’on n’était pas amoché par l’alcool (…) parce que ça amplifie les effets de l’alcool.»
Initiation et poursuite de la consommation : le rôle des pairs
L’envie d’éprouver de nouvelles sensations est systématiquement citée comme principale motivation à l’expérimentation du protoxyde d’azote. Les pairs jouent alors un rôle central : ils décrivent positivement les effets du gaz au novice et insistent sur son caractère supposément inoffensif .
Maxime, 32 ans, témoigne : « Mes potes me demandent et je leur dis que c’est des douilles de gaz hilarant, et je leur raconte que c’est marrant, comme du poppers, que ce n’est pas dangereux ».
Ambre, 24 ans, a ainsi été convaincue d’expérimenter par des proches étudiants en médecine : « Mes potes m’ont rassurée la première fois. Ils m’ont dit t’inquiète, c’est du gaz, ça rentre dans les poumons puis ça ressort, il n’y a pas de problème (…) ».
Les pairs plus « expérimentés » endossent également un rôle de transmission des techniques nécessaires d’usage du protoxyde d’azote afin notamment de limiter certains risques (consommer assis afin d’anticiper le risque de chute engendré par une éventuelle perte de connaissance, limiter le nombre de cartouches consommées et espacer les prises pendant la soirée…). Les usagers interrogés ont ainsi connaissance des risques immédiatement liés à la consommation et adoptent des pratiques visant à les réduire. Néanmoins, ils se montrent peu concernés par les conséquences sanitaires négatives (comme des troubles neurologiques et neuromusculaires) documentées en particulier par les Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A). Ces dommages peuvent survenir lors de consommations intensives et répétées mais ces usagers les considèrent comme éloignés de leurs pratiques.
Le Tendances n°151 montre ainsi que les consommations de protoxyde d’azote observées s’inscrivent dans les sociabilités festives juvéniles et s’intègrent au sein de polyconsommations. Il souligne également que le faible prix et la forte disponibilité du gaz contribuent au développement des consommations, malgré les tentatives des pouvoirs publics d’en restreindre l’accès aux mineurs. Le protoxyde d’azote reste en effet aisément accessible, du fait notamment d’une diversification des acteurs de l’offre (épiceries, boîtes de nuits, bars, commerces de proximité…) et les moyens d’approvisionnement (réseaux sociaux, internet…).
• Tendances n°151 : Les usages psychoactifs du protoxyde d’azote. Août 2022 OFDT, (PDF)
• Communiqué de presse OFDT, 30 août 2022 : « Usages psychoactifs du protoxyde d’azote : accès, contextes
d’usages et perceptions du risque » (PDF)