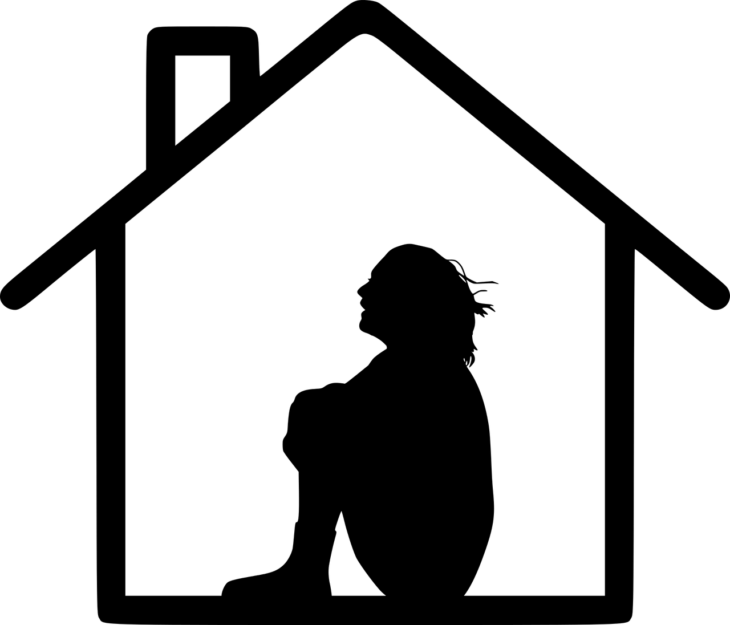Cet avis est probablement le dernier du Conseil scientifique COVID-19, qui devrait laisser la place au futur comité de veille sanitaire. Ni testament ni retour d’expérience, il aborde plusieurs points clés dont celui de la santé mentale.
L’impact de la pandémie COVID-19 sur la santé mentale est maintenant bien établi, allant de la dégradation de certains paramètres de santé mentale en population générale, jusqu’à l’augmentation de troubles psychiatriques, tout particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes.
Les données en population générale française retrouvent une dégradation de plusieurs paramètres de santé mentale, comprenant des troubles du sommeil, des manifestations anxieuses et dépressives principalement (étude COVIPREV, Santé Publique France), avec l’identification de facteurs de risque tels que l’âge (sujets jeunes), des difficultés économiques, et des antécédents de troubles psychiatriques. En mai 2022, tous les indicateurs restent significativement plus élevés qu’en période hors épidémie : pensées suicidaires (11,3% des personnes versus 4,7 %), symptômes dépressifs (15,1% versus 9,8%), anxiété (25,4% vs 13,5%). Comparativement aux données datant du début de la pandémie, les données plus récentes montrent un maintien du niveau d’anxiété, une diminution du niveau de dépression mais une augmentation des pensées suicidaires. En revanche, on n’observe pas la même augmentation de gestes suicidaires chez les adultes que chez les plus jeunes.
Depuis l’automne 2020 (au moment de la 2ème vague et par conséquent de la 2ème série de mesures de freinage de la circulation du virus et à la suite de la rentrée scolaire post estivale) est constatée une forte augmentation des demandes de soins ambulatoires et hospitaliers pour les adolescents en raison de troubles anxieux et dépressifs, ainsi que d’idéations et de gestes suicidaires (Cousien et al 2021). Les données de Santé Publique France rapportent une augmentation des passages aux urgences pour ces mêmes troubles, en significative augmentation comparativement aux 2 années précédentes (pour les 11-17 ans en 2021: augmentation de + 60 % pour les troubles dépressifs et de +126% pour les gestes suicidaires) (données issues du réseau OSCOUR représentant 93% des passages aux urgences en France). Ces données restent préoccupantes en mai 2022 avec une persistance de chiffres élevés, supérieurs aux années précédentes pour les gestes suicidaires et les troubles dépressifs, en sachant par ailleurs que tous les patients souffrant de troubles psychiatriques ne passent pas tous par des urgences d’hôpitaux généraux. Les mêmes constats sont faits dans d’autres pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis (Yard et al, 2021). Les décès par suicide sur l’année 2020 n’étaient pas augmentés mais nous ne disposons pas à l’heure actuelle de ces chiffres pour l’année 2021. Les hypothèses étiopathogéniques sont multiples (climat anxiogène lié à la pandémie ou à d’autres contextes, discontinuité et difficultés scolaires, difficultés intra familiales, difficultés économiques, diminution des liens sociaux, exposition accrue aux écrans, antécédent de troubles des apprentissages ou psychiatriques, …).
Une autre population à risque de présenter des symptômes psychiatriques et cognitifs selon plusieurs études est celle des personnes ayant été malades du COVID-19. Une étude de cohorte sur un très large échantillon rapporte une augmentation significative de troubles anxieux et dépressifs, de troubles de l’adaptation, de troubles du sommeil, de troubles cognitifs et d’abus de substances comparativement à deux groupes contrôles (Yan Xie et al, BMJ 2022) *.
En dernier lieu, il est essentiel de souligner que cette dégradation des paramètres de santé mentale, mais surtout l’augmentation de la nécessité de soins psychiatriques chez les adolescents et jeunes adultes survient dans un contexte de crise hospitalière et de très grande tension de la psychiatrie en France (manque d’infirmiers et de médecins, déficit de lits d’hospitalisation notamment en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) et à l’étranger. Divers rapports ont alerté sur cette situation (rapport sur la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, M. Amiel, Sénat 2017 et rapport du Défenseur des droits, C. Hédon, 2021).
Une optimisation des ressources sur chaque territoire est indispensable, après avoir ciblé les réalités de terrain, sur les acteurs de soins de santé primaires disponibles et mobilisables. Il faut quitter la vision encore trop hospitalo-centrée, pour ouvrir vers des pistes de travail coordonné et pluridisciplinaire.
*troubles anxieux : Hazard Ratio= 1.35, (IC 1.30-1.39))/ troubles dépressifs HR=1.39 (IC 1.34-1.43)/ stress et troubles de l’adaptation HR=1.38 (IC 1.34-1.43)/ troubles cognitifs HR=1.80 (IC 1.72-1.89)/troubles du sommeil HR=1.41 (IC 1.38-1.45).
« Vivre avec las variants – La pandémie n’est pas terminée – Mieux anticiper », Avis du Conseil scientifique COVID-19, 19 juillet 2022 – L’avis [PDF]