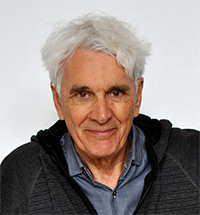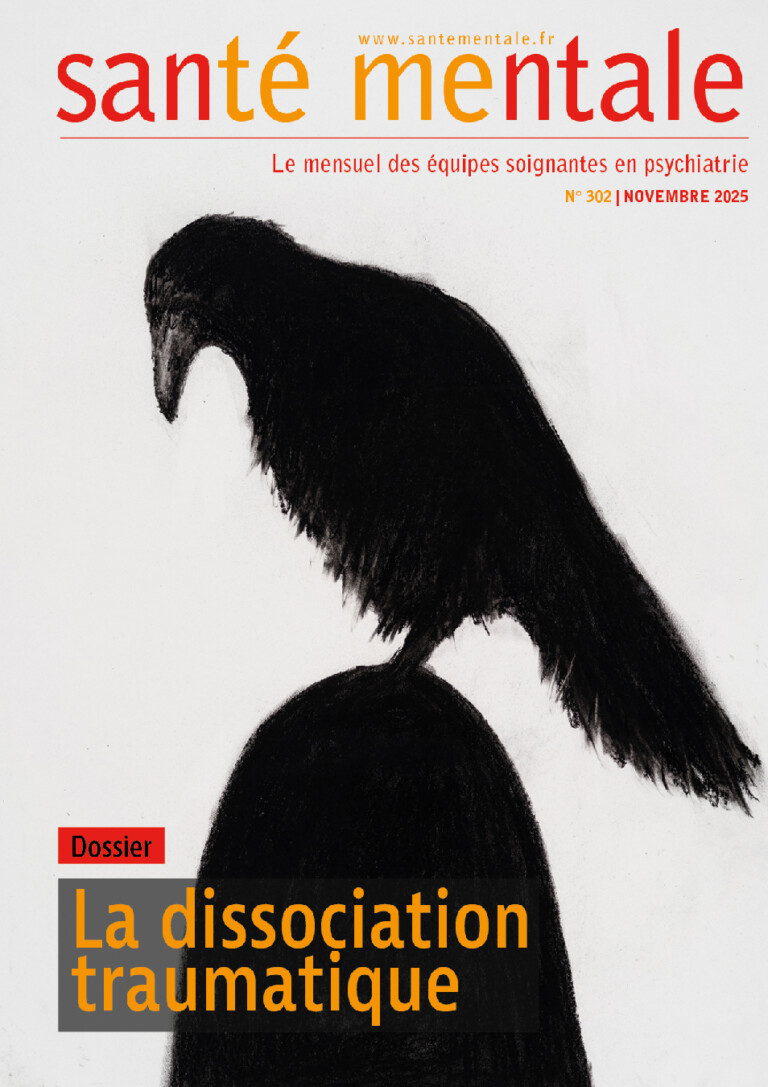Le conseil scientifique du Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) du 24 novembre restera comme le dernier animé par le Dr Jean-Luc Roelandt en tant que Directeur. C’est en effet au cours de cette réunion qu’il a passé le flambeau au Dr Déborah Sebbane, jusque-là directrice adjointe du centre, et qui a reçu à cette occasion l’avis favorable unanime des membres du conseil. Dans cette interview accordée à la Lettre du GCS, il pointe les défis qui restent à relever.
Vous avez transmis, le 3 décembre, la Direction du CCOMS au Dr Déborah Sebbane. En quoi un Centre collaborateur de l’OMS vous semble utile dans le paysage de la santé mentale française ?
"L’OMS nous demandant de relayer sa politique en matière de santé mentale, nous avons introduit ou accompagné en France plusieurs dispositifs qui émanent directement de ses recommandations et s’inspirent de ce qui a fait ses preuves à l’étranger. Je citerais quelques exemples : le développement des équipes mobiles de santé mentale ; les Médiateurs de santé pairs ; le Diplôme inter-universitaire Santé mentale dans la communauté (qui a formé près de 400 personnes) ; le programme Quality Rights (qui fait passer la qualité des soins par le respect des droits et de la liberté des usagers) ; l’accompagnement de l’essor des Conseils locaux de santé mentale (CLSM), véritables outils de mise en œuvre d’une santé mentale intégrée à la cité (création française qui a intéressé aussi bien l’OMS que l’Europe) ; l’enquête Santé mentale en population générale (qui décrit à la fois les représentations sociales des populations et les besoins des territoires).
Le centre collaborateur de Lille c’est aussi l’animation d’un réseau de plusieurs dizaines de partenaires, qui œuvrent ensemble à l’amélioration de la prise en compte des questions de santé mentale dans notre société. Il y a nos partenaires proches du conseil scientifique, mais aussi les 25 établissements du GCS, les associations d’usagers, d’aidants et d’élus locaux, les diverses institutions, les services des ministères et les dizaines de pays où nous sommes intervenus.
Je n’oublie pas la recherche, qu’elle soit nationale (HO/SDRE, médecine générale, etc.) ou internationale (révision de la classification internationale des maladies, e-santé mentale, et), sur des thématiques variées : risques psychosociaux (RPSY), le tabac en psychiatrie (Tabapsy), les co-morbidités (COPSYCAT), etc. Toutes ces recherches ont la particularité d’être co-conçues dès le début avec les usagers de services et personnes directement concernées (qui sont indemnisés pour cela), les professionnels et les chercheurs, et poursuivies avec eux jusqu’à l’application concrète de leurs résultats sur le terrain. Un centre collaborateur a aussi pour mission de traduire les principaux documents de l’OMS afin de les rendre accessibles pour la France et les pays francophones ; d’organiser des événements et colloques nationaux et internationaux ; de communiquer sur l’actualité de l’OMS et de la santé mentale dans la communauté. En résumé, un CCOMS, c’est articuler une pensée globale (les recommandations de l’OMS) à des actions locales, en restant à l’écoute des évolutions sociales et internationales. C’est indispensable, sinon on reste dans l’incantatoire !"
Quelle a été l'influence de l'OMS sur les politiques de santé mentale en France ?
"On peut dire que les lignes bougent, même si c’est très, très lent… L’OMS prône depuis plus de deux décennies le déploiement des ressources de promotion et prévention de la santé mentale et de soins dans la communauté, au plus près des populations, par redéploiement des ressources des lieux d’hospitalisation. En France, la logique de la sectorisation psychiatrique, qui confie à la même équipe le soin, la prévention, la réadaptation, la postcure, la promotion et qui considère que l’hospitalisation n’est qu’un moment dans le parcours de soins du patient, peut être considérée en théorie comme un prototype mondial. Mais cette politique n’a jamais été menée à son terme. Pourtant la France bénéficie d’une protection sociale très conséquente comparée à d’autre pays où elle est très limitée, et l’investissement financier pour la psychiatrie et la santé mentale est largement au niveau. Mais les moyens financiers et humains restent trop focalisés sur le soin (et particulièrement l’hospitalisation) au détriment de la prévention, très mal répartis géographiquement et pas assez présents dans les quartiers en difficulté.
La question de la santé mentale recoupe celle plus large de la santé puisque les déterminants sont les mêmes (inégalités sociales, habitat, éducation, emploi, genre…) et ceux-ci constituent le socle de la prévention. Le suicide reste encore à un niveau élevé dans notre pays, malgré une évolution favorable ces derniers temps, corrélative de la création de l’Observatoire national du suicide. Le poids de la stigmatisation demeure un frein puissant. Elle ne pourra diminuer que sous l’impulsion des usagers et des aidants. Notons toutefois que sous l’impact de la période épidémique et ses conséquences, il semble que l’idée que l’on a toutes et tous une santé mentale semble faire son chemin.
Avec les lois de 2002 et 2005, on est passé du malade à l’usager, du handicapé à la personne en situation de handicap, et nous progressons vers la citoyenneté pleine et entière pour toutes et tous. Si la psychiatrie fait davantage participer les usagers, mais aussi les élus et les citoyens eux-mêmes, elle s’en trouvera grandie.
D'ailleurs, on remarque de plus en plus d’initiatives allant dans le sens des demandes de l’OMS. Les mentalités changent et l’investissement dans la santé mentale est à l’agenda en France, mais aussi ailleurs, par exemple dans les pays que le CCOMS a accompagné dans leurs réformes en santé mentale. Beaucoup de partenariats locaux œuvrent à améliorer le parcours de santé mentale et l’intégration sociale. Les associations d’usagers et d’aidants se font mieux entendre et les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont devenus des ressources essentielles. Les attitudes changent : la manière dont se développe aujourd’hui le programme des médiateurs de santé pairs était inenvisageable au début, il y a 10 ans. Notons aussi le développement exponentiel des actions des Semaine d’information sur la santé mentale (SISM), l’expansion nationale du Psycom, le développement du programme "Un chez soi d’abord", le déploiement des CLSM et des PTSM, ainsi que la création de la première Délégation Ministérielle à la Santé mentale et à la Psychiatrie, qui accompagne la mise en place d’une Feuille de route explicite. Soulignons enfin que le concept de rétablissement est apparu dans les textes officiels, après avoir été prôné par l’OMS ainsi que les Droits humains, l’empowerment, et le décloisonnement entre institutions de santé, d’éducation, de logement, de sécurité, d’emploi, de justice et de culture qui œuvrent toutes à la santé.
Mais il faut amplifier ce mouvement ambulatoire et sociétal, ne pas s’arrêter en chemin, créer autant de CLSM qu’il y a de secteurs de proximité, développer les formations universitaires de médiateurs de santé pairs dans toutes les universités, créer un statut pour les usagers en démocratie sanitaire et développer une politique de santé mentale interministérielle ambitieuse."
Quels sont selon vous les plus grands défis auxquels la psychiatrie française doit faire face ?
"Il manque un cap et une forte volonté politique qui s’inscrive dans le temps. A l’échelon national mais aussi souvent aux différents niveaux locaux.
Premier défi : il faut terminer le virage ambulatoire pour consolider les soins dans la Cité. Nous en sommes à 97 lits pour 100 000 habitants, soit un des pays qui en a le plus au monde, quand l’Italie et l’Espagne en sont à moins de dix, l’Angleterre à 23. Ces chiffres sont stables en France depuis 10 ans, voire en légère augmentation du fait de l’augmentation des capacités privées, qui ont une durée moyenne de séjour deux fois plus importante que dans le public. Actuellement, la plupart des personnels – surtout en psychiatrie adulte – sont concentrés à l’hôpital psychiatrique alors que plus de 85 % des patients des files actives ne sont pas hospitalisés et qu’ils vivent chez eux, le temps passé à l’hôpital étant de moins de 0,01 % de leur vie.
Les équipes mobiles de psychiatrie et précarité se développent. Mais on sait que les équipes mobiles de soins aigus intensifs dans la cité, véritables alternatives aux soins hospitaliers, qui font chuter la durée d’hospitalisation et diminuer drastiquement le nombre de lits nécessaires n’ont pas fait l’objet d’un déploiement aussi massif. Il est préféré des équipes spécialisées qui ne répondent pas à l’alternative à l’hospitalisation et ne font pas diminuer le nombre des lits. De même pour les équipes de suivi au long cours pour les personnes ayant des troubles psychiques sévères. Les équipes d’Assertive Community Treatement (ACT) auraient dû être déployées massivement en lien avec la réhabilitation psycho-sociale, cette dernière ne pouvant être efficace que dans le milieu de vie habituel de l’usager, et non à l’hôpital. Mais ceci nécessite que soient logés dignement ces mêmes usagers. D’où l’importance des élus locaux.
Deuxième défi : réduire les inégalités territoriales qui sont massives. Les taux de psychiatres pour 100 000 habitants varient de 1 à 40 pour les psychiatres privés, de 1 à 5 pour les secteurs de psychiatrie publiques (certains n’ont plus de psychiatres à ce jour !). Les taux de personnels para médicaux varient de 1 à 3, ceux de psychologues de 0 à 50, les temps d’attente pour un rendez- vous de 1 à 110 jours, avec une moyenne de 21 jour en adulte et de 110 en infanto juvénile ! Ces différences ne peuvent être expliquées par l’épidémiologie. Les troubles mentaux touchent tout le monde, mais beaucoup plus les populations pauvres, qui vivent dans des déserts médicaux.
En outre, les politiques n’ont jamais pris une position claire sur le choix entre secteur public et privé. Les deux coexistent et sont concurrentiels. Les salaires sont différents les systèmes de financement aussi (on verra ce que donnera la réforme repoussée en 2022, qui, espérons-le, devrait favoriser fortement l’ambulatoire et les soins hors contrainte, tenir compte des caractéristiques des populations desservies et de leur nombre…). En conséquence, le secteur public a dû se restructurer, quand le privé augmentait le nombre de lits. Ceci a rendu les politiques de redéploiement dans la cité illisibles. L’attractivité financière a de plus fait basculer un nombre important de psychiatres vers le privé.
Troisième défi : agir partout contre le non-respect des droits fondamentaux en psychiatrie.
Les hospitalisations sans consentement ont augmenté ces dernières années. Il n’y a toujours pas d’observatoire des soins sans consentement, et à ce jour il n’existe toujours pas de chiffres précis sur les évolutions de ces pratiques. Mais l’action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le programme Quality Right porté par l’OMS, les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des usagers et des familles et l’engagement de nombreux professionnels ont fait bouger les lignes et permis une prise de conscience.
Quatrième défi : reconnaître l’importance de la santé physique pour les personnes recevant des soins psychiatriques. L’espérance de vie des malades soignés en psychiatrie reste inférieure de 16 ans en moyenne par rapport à la population générale. Les troubles psychiques concernent un quart des patients en médecine générale et celle-ci est la porte d’accès la moins stigmatisante aux soins en santé mentale. Néanmoins, les liens entre la médecine générale et les secteurs de psychiatrie sont encore très peu développés dans la plupart des territoires.
Cinquième défi : il nous manque un grand plan de reconversion des hôpitaux psychiatriques en établissements publics de santé mentale avec des services intégrés dans la cité, avec quelques lits d’hospitalisation à l’hôpital général quand c’est nécessaire. Ce modèle, tenant compte aussi de la reconversion et de la mobilité des personnels existe dans d’autres pays. Pourquoi pas dans le nôtre ? Et un financement incitatif favorisant résolument les soins en ambulatoire ainsi que les programme de prévention, de promotion de santé mentale et d’information et de communication dans la population générale.
La période épidémique a permis une prise de conscience pour la population et les décideurs de l’importance de la santé mentale de toutes et de tous. Elle a mis en évidence aussi des capacités d’adaptation très rapides du système de soins pour garder le lien avec des personnes isolées (chute des admissions et séjours en hôpital psychiatrique, téléconsultations, e-santé mentale, réactivité des CLSM et des initiatives des villes, solidarité des habitants…). Cela démontre que la mutation vers un système de santé mentale intégré dans la cité est parfaitement possible et peut se faire rapidement, si la situation le nécessite.
Sixième défi : l’implication forte des élus et élues. Si l’on veut réduire le fossé entre des systèmes de soins psychiatriques coexistant dans le même pays, voire dans la même ville, certains ambulatoires, centrés sur les droits et complètement ouverts, et d’autres fermés, centrés sur l’hospitalisation avec peu de suivi et d’intégration dans la cité pour les usagers, la question à se poser est pourquoi les exemples de pratiques communautaires bien documentés ne se diffusent pas aussi vite que l’on serait en droit d’espérer. L'explication de ce fossé entre le "penser global" et l’application locale est peut-être à rechercher du côté des représentations sociales de la "Folie", de la "Maladie Mentale", qui imprègnent encore les pratiques de la psychiatrie, en particulier les stéréotypes qui touchent à la dangerosité et à l’imprévisibilité des patients. Pour déconstruire collectivement les représentations sociales négatives et dépasser les clivages et cloisonnements qui jalonnent les pratiques des acteurs, une implication à la fois nationale et locale serait utile, passant par l’information, la communication et la formation tant des psychiatres et des intervenants en santé (mentale) et du social, que de la population, dès l'écoles et dans les entreprises, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, avec une attention particulière aux quartiers défavorisés et aux déserts ruraux. Nos élus, nationaux, mais aussi locaux, doivent prendre des décisions allant dans ce sens et s’impliquer. Les choses ont déjà changé positivement ces dernières années, mais il y a encore un effort à faire.
Pour ma part, je poursuivrais quelques temps mon engagement en tant qu’adjoint à la nouvelle Directrice du CCOMS, afin de consolider une transition tranquille, débutée depuis trois ans déjà. Je suis convaincu que les actions du CCOMS poursuivront leur développement dans les années à venir, et continueront de promouvoir avec conviction en France les valeurs humanistes promues par l’Organisation mondiale de la santé."